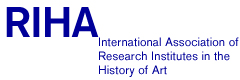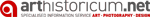RIHA Journal 0147 | 15 February 2017
L’art de la reprise dans la collection de Gaston de Saint-Maurice : entre art mamelouk égyptien et décors intérieurs des xviie-xviiie siècles
Abstract
By studying objects from the former collection of the French collector Gaston de
Saint-Maurice (1831-1905) now in the Louvre and the Musée des Arts
décoratifs in Paris, this article elucidates different aspects of the
taste for reuse of architectural elements and decorative artefacts in the 19th
century. Known for his collection of Islamic art (acquired by the South
Kensington Museum in 1883), Saint-Maurice also collected European decorative arts
showing his taste for historical decors. This article also raises the question of
the appropriation of such artefacts by museums today.
Table des matières
Aristocrate, dandy et collectionneur
Collectionner le fragment, penser le décor : la collection
kaléidoscopique de Gaston de Saint-Maurice
La dispersion d’une collection
Aristocrate, dandy et collectionneur
[1] Au foyer de la danse de l’Opéra, chez les “hétaïres” huppées dont les protecteurs formaient une confrérie, la tenue était celle de la meilleure société, mais on n’y était pas chiche d’indiscrétions sur l’intimité conjugale des hommes mariés, les “potins” risquaient moins de déborder les frontières d’un étroit Tout-Paris : l’aristocratie riche et libre de mœurs. Le prince de Sagan, Edmond de Polignac, Saint-Maurice, l’Écossais Strachan, l’Anglais Vansittart, piliers du Jockey Club, perpétuaient les traditions des d’Orsay, des Laffitte, des Morny, des lord Hamilton et des Hertford, lions du boulevard des Italiens au temps de la Maison d’Or et du Café des Anglais1.
[2] Dans le souvenir du peintre Jacques-Émile Blanche, Gaston de Saint-Maurice, dandy parisien devenu grand écuyer à la cour égyptienne en 1868, est l’un des personnages qui peuplent ce décor évoquant les ambiances mondaines des cercles parisiens du Second Empire. Saint-Maurice y demeure associé par l’imposant tableau de James Tissot, Le Cercle de la rue Royale2. À l’instar du Jockey Club, ce cercle restreint voire exclusif, fondé en 1852 et d’obédience royaliste, réunissait les jeunes représentants de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie du Second Empire. Gaston de Saint-Maurice y côtoie quelques-uns des personnages cités sous la plume de Jacques-Émile Blanche – le prince Edmond de Polignac et le capitaine Coleraine Robert Vansittart –, mais aussi les marquis de Miramon et de Ganay, le baron Hottinger et le très proustien Charles Haas.
[3] Charles Gaston Esmangart de Bournonville, comte de Saint-Maurice, plus souvent nommé Gaston de Saint-Maurice, est né le 17 avril 1831 à Compiègne3. Il est le fils de Louis-François Esmangart de Bournonville (1797-1860), dit de Saint-Maurice et de Marie-Louise Bézin d’Élincourt (1802-1851)4. La famille Esmangart a occupé une place importante dans l’histoire de Compiègne. Originaire de la Lorraine allemande, elle y serait arrivée au xve siècle et acquit, vers 1530, le fief de Bournonville, situé en bordure de Compiègne. Elle le vendit en 1763 à la marquise de Pompadour5. À la fin du xviie siècle, parmi ses alliances célèbres, on compte la famille Séroux d’Agincourt dont est issu Jean-Baptiste-Louis-Georges Séroux d’Agincourt (1730-1814), auteur de l’Histoire de l’art par les monumens, depuis sa décadence au ive siècle jusqu’à son renouvellement au xive siècle (1823)6. Le nom est intimement lié à l’histoire locale dans la mesure où plusieurs membres de la famille Esmangart de Bournonville ont occupé des fonctions administratives à Compiègne sur plusieurs générations7. Il n’est donc pas étonnant de retrouver en 1832 un certain comte de Saint-Maurice, père du collectionneur, nommé Introducteur des ambassadeurs à l’occasion du voyage du roi Léopold Ier de Belgique à Compiègne8. Les archives du musée national du château ne conservent pas trace de la présence de Gaston de Saint-Maurice aux célèbres « séries » de Compiègne, animées par le couple impérial sous le Second Empire. On peut cependant supposer qu’il y fût invité9.
[4] À l’exception de la période durant laquelle il vécut au Caire, de 1868 à 1878, Gaston de Saint-Maurice résida la plupart du temps à Paris. Si on lui connaît plusieurs adresses, il semble avoir vécu le plus longtemps au 12, rue de Penthièvre, dans le VIIIe arrondissement10. Aristocrate et dandy, Saint-Maurice possédait également une propriété à Dieppe, en Haute-Normandie11. À la faveur de l’établissement de bâtiments de bain, notamment à Pourville-sur-Mer dès 1815, cette région devint dans les années 1850-1860 un lieu de villégiature privilégié de l’aristocratie parisienne puis londonienne. À partir de 1880, des palaces et casinos s’érigent et y attirent une élite européenne. De nombreuses demeures y sont alors louées pendant la saison estivale12. C’est le cas de la villa de Gaston de Saint-Maurice, louée au baron Jacques de Günzburg moyennant 7000 francs par an13. Cette région, étudiée dans l’article de Viviane Manase, fut le lieu de constructions architecturales historicistes précoces. Les exemples que développe l’auteur sont évocateurs : la villa Le Donjon à Étretat (construite en 1862 puis agrandie en 1869), la villa mauresque construite à Yport par l’architecte Émile Marquette (1878-1879) et d’autres exemples plus tardifs, comme le casino mauresque de Dieppe ou le Grand Hôtel du casino de Pourville-sur-Mer (1905), dont le corps principal offrait de nombreuses références médiévales (tours, tourelles, archères et grandes toitures). Peu d’informations nous sont parvenues sur la propriété dieppoise de Saint-Maurice ; il semble néanmoins que cette villa renfermait des décors dont certains fragments furent vendus au moment de la succession Saint-Maurice en 190614.
[5] De Dieppe au Caire, on pourrait multiplier les exemples de constructions architecturales historicistes au xixe siècle. Gaston de Saint-Maurice fut en effet l’un de ces « fous du Caire »15 qui, à partir des années 1870 et à la faveur de son nouveau titre de grand écuyer du vice-roi, collectionna des fragments de monuments de l’art arabe égyptien16. Comme d’autres amateurs français résidant au Caire à cette même époque17, sa pratique de la collection eut la particularité d’être étroitement liée à des projets de création, de « recréation » architecturale18. Nous souhaitons ici mettre en perspective le contexte particulier de la construction de l’hôtel Saint-Maurice au Caire19 avec les éléments nouveaux qui permettent d’éclairer la constitution et la diversité de sa collection personnelle20. Cette collection, en partie conservée au Louvre (département des Arts de l’Islam), au musée des Arts décoratifs et au Victoria and Albert Museum à Londres, se compose principalement d’objets d’arts décoratifs appartenant à ce que nous appelons aujourd’hui les « arts de l’Islam », en particulier l’art mamelouk21. Cependant, cette collection offre également un ensemble de dessins ornementaux et d’objets décoratifs en bronze des xviie et xviiie siècles. L’histoire du goût et l’étude des collections constituent des approches très pertinentes pour comprendre les déplacements de décors et d’architecture22. C’est pourquoi la collection de Gaston de Saint-Maurice est intéressante dans différentes perspectives : elle permet d’étudier, parallèlement à la formation précoce d’une collection d’art islamique, l’art du remploi ou de la reprise dans des constructions architecturales historicistes23. À la manière d’un kaléidoscope, la collection Saint-Maurice invite à considérer les diverses formes que l’art du remploi a connues au cours du xixe siècle. Elle illustre une pratique de la collection intimement liée à l’architecture domestique et témoigne de la « vie sociale des objets »24, pour la plupart fragments de décors historiques disparus ou déplacés.
[6] À mi-chemin entre l’outil scientifique et l’outil de prestidigitation, le kaléidoscope possède un nombre fini d’éléments dans un espace clos, mais autorise cependant un nombre infini de combinaisons. Il illustre une manière de créer du nouveau par le seul réagencement de ce qui est déjà existant. Cette image permet également d’illustrer l’idée selon laquelle un objet ne découle pas de la simple addition des éléments qui le composent, mais de la forme que prend leur combinaison. L’usage de l’image du kaléidoscope que fait Claude Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage (1962) pour décrire la logique « sauvage » suggère un parallèle intéressant : « Cette logique opère un peu à la façon du kaléidoscope : instrument qui contient aussi des bribes et des morceaux, au moyen desquels se réalisent des arrangements structuraux »25.
Collectionner le fragment, penser le décor : la collection kaléidoscopique de Gaston de Saint-Maurice
[7] De manière métaphorique, les objets qui composent la collection Saint-Maurice évoquent les « infinies combinaisons d’images aux multiples couleurs »26 du kaléidoscope. L’usage des décors que fait Saint-Maurice dans son hôtel cairote confère à cette œuvre architecturale, dont le projet fut pensé par Ambroise Baudry, un caractère unique fondé sur des recréations architecturales27. Le contexte particulier des démolitions dans le cœur historique du Caire – provoqué par les grands travaux urbains d’embellissement lancés à partir de 1868 – favorise l’affluence sur le marché d’ensembles ou de fragments de décors issus de demeures et de mosquées médiévales28. Dans l’hôtel Saint-Maurice, ces décors historiques côtoient une importante collection d’objets d’art qui densifie les combinaisons d’images offertes par cet écrin architectural entre imaginaire et savoir. Comme l’a montré Mercedes Volait, « les codes sont subvertis, les objets sont détournés de leur fonction initiale, le décor est à la fois mimétique et de pure invention »29.
[8] Cet ouvrage, inscrit dans un contexte géographique et une période bien définis, fut rendu possible par une conjonction de circonstances favorables sur un plan personnel : statut de grand écuyer du khédive, aisance financière, concession d’un terrain à bâtir, affluence d’objets sur le marché. Faut-il pour autant le réduire à l’expression d’une pratique purement conjoncturelle et passagère ? Il semble que Saint-Maurice n’ait pas été qu’un collectionneur opportuniste ou occasionnel. Dès le début des années 1860, il possédait une importante collection d’objets d’art, qui associait arts décoratifs islamiques et européens des xviie-xviiie siècles30. En 1878, à son retour du Caire, la collection Saint-Maurice approchait le millier d’objets. Son affection pour les arts décoratifs en général et pour les arts de l’Islam en particulier n’était donc pas de circonstance. S’accompagnant de l’art du remploi des objets, elle témoignait bien plutôt d’une sensibilité de précurseur31. À la faveur de phénomènes de circulation semblables à des girations de kaléidoscope, ces objets pénètrent de nouveaux espaces qui leur confèrent une nouvelle « vie sociale », tout en conservant toutefois les traces matérielles de leur usage originel – c’est ce qui fait la valeur documentaire voire archéologique de la collection Saint-Maurice.
[9] Si les objets de la collection Saint-Maurice conservés dans les musées et devenus célèbres depuis constituent traditionnellement un échantillon précieux pour étudier l’histoire du goût et celle du remploi, le reste de sa collection, moins connu, n’en est pas moins intéressant dans cette perspective. En 1865, Saint-Maurice prête plusieurs objets à l’Exposition rétrospective des beaux-arts et des arts appliqués à l’industrie32. À son retour du Caire en 1878, la collection, exposée au palais du Trocadéro dans le cadre de l’Exposition universelle, y demeure jusqu’à son achat par le South Kensington Museum en 188333. En 1893, le musée des Arts décoratifs achète au collectionneur un lot de « boiseries arabes » et de bronzes d’ameublement d’époque moderne34 et, en 1903, Saint-Maurice prête trois objets à l’Exposition des Arts musulmans35. Aspect encore inédit dans les recherches consacrées au collectionneur, deux ventes aux enchères éclairent la constitution de sa collection après l’achat par le South Kensington Museum. La première est une vente d’estampes, de dessins et d’ornements des xviie et xviiie siècles organisée en 1893 et à laquelle le musée des Arts décoratifs achète plusieurs œuvres36. La seconde a lieu en 1906 après le décès du collectionneur37.
[10] Les « boiseries arabes », les bronzes d’ameublement d’époque moderne ou encore les dessins acquis par le musée des Arts décoratifs en 1893 attestent que Saint-Maurice fut sans nul doute un collectionneur sensible à la « beauté intrinsèque du fragment » telle qu’elle a été pensée par Bruno Pons38. Les années 1860 éclairent l’existence d’une véritable industrie du remploi, bientôt étendue à une échelle internationale39. Si l’idée de reconstitution change avec les époques, le déplacement d’ensembles ou de fragments de décors reste intimement lié à l’effervescence d’un commerce remarqué par des ventes formelles ou informelles40. Qu’ils soient étroitement liés à l’éveil d’une conscience patrimoniale ou non, ces remontages et ces reconstitutions comportent une part de fantastique. En observant de plus près les objets de la collection Saint-Maurice conservés dans les musées, on cerne toute l’ambiguïté d’une pratique qui, en recréant l’ambiance d’une époque révolue, expose, juxtapose et assemble des éléments authentiques avec des pastiches et des matériaux contemporains41.
[11] Les boiseries éclairent particulièrement la pratique du remploi. Un panneau de porte ou élément de joue de minbar (fig. 1) offre un exemple du type de remontages de fragments anciens qu’affectionnait Saint-Maurice42.
1 Elément de joue de minbar ? Fin du xiiie siècle – 1ère moitié du xive siècle. Musée du Louvre, Paris (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Claire Tabbagh)
L’objet est en bois sculpté et présente trois compartiments. Celui du milieu comporte un décor d’arabesque en marqueterie de bois foncé et d’os, formant par l’entrecroisement de nervures rectilignes une grande rosace, dont le centre est occupé par une étoile à douze branches. Autour de cette étoile rayonnent des médaillons de formes hexagonales variées renfermant des ornements feuillagés43. Après étude scientifique, il apparaît que le compartiment central date de la fin du xiiie siècle ou du début du xive siècle – cette partie est sculptée de motifs floraux (arabesques) typiques des productions égyptiennes de cette époque44. La position des motifs sculptés dans l’ivoire tend à prouver que la lecture du décor se déroulait initialement dans le sens de la longueur du panneau. Provenant probablement d’un minbar45 puis intégré au xixe siècle dans un panneau de porte, la lecture s’en est trouvée modifiée. On constate alors que l’élément ancien est réutilisé comme un élément décoratif. La restauration de l’objet a notamment révélé que le bois du panneau diffère de la marqueterie puisqu’il est en résineux. Parmi les onze boiseries achetées par le musée des Arts décoratifs en 1893, certaines témoignent de la fonction décorative attribuée à ces fragments par le collectionneur. Un panneau d’encadrement (fig. 2) restauré en 2009 fait état d’ajouts de bois « récents » fixés au revers pour en assurer le maintien46.
2 Panneau d’encadrement en bois avec un décor assemblé d’os et de nacre, Proche-Orient arabe/Égypte, s. d. Musée du Louvre, Paris (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Claire Tabbagh)
D’autres interventions, tels des percements visibles en périphérie, semblent avoir eu pour fonction d’assurer la fixation de l’objet. Des comblements et des traces de matière picturale ont visé à améliorer la présentation de l’objet.
[12] Une autre boiserie, un panneau épigraphié daté du xive siècle, présente des modifications caractéristiques d’un objet soumis à la pratique du remploi (fig. 3)47.
3 Boiserie avec inscription tirée de la Sourate 7, verset 21 : « Telle est la grâce de Dieu ! Il donne à qui il veut. Dieu est le maître de la Grâce incommensurable. » Égypte, xive siècle. Musée du Louvre, Paris (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Hervé Lewandowski)
Plusieurs interventions visibles sur cette boiserie renvoient à la fonction décorative qui lui fut probablement attribuée : des trous évoquent un ancien système d’attache au moyen de clous et, au revers, une plaquette munie d’anneaux métalliques témoigne d’un second système de fixation. D’autre part, l’objet conserve des traces de découpage et de consolidation de fentes à l’aide de colle animale. Ces fragments, réutilisés comme des pièces décoratives, mettent en exergue une pratique qui témoigne d’une forme d’appropriation du fragment fondée sur des continuités fictives entre le présent et les cultures du passé48. Jacqueline Lichtenstein définit le fragment comme un morceau brisé ou détaché d’un ensemble. Cette définition du fragment dans des termes physiques lui confère donc également une dimension temporelle. En effet, il n’est pas seulement cassé ou détaché, il est aussi un élément « rescapé »49. Subverti à des fins décoratives, il renvoie au kaléidoscope qui offre d’infinies combinaisons entre historicisme, fragmentation, mémoire, authenticité et appropriation50.
[13] Le lot de boiseries acheté à Saint-Maurice se compose principalement de panneaux de portes à décors d’assemblage incrustés d’ivoire, d’os ou de nacre (fig. 4). Ces décors d’assemblage souffrent d’importantes lacunes (fig. 5)51.
4 Panneau à l’étoile à douze pointes, bois (ébène), décor incrusté d’os, Égypte, xive-xvie siècle ?, Musée du Louvre, Paris (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Claire Tabbagh/Collections Numériques)
5 Partie de panneau de porte, bois, décor d’assemblage (bois et os), Proche-Orient arabe/Égypte, xiiie-xive siècle. Musée du Louvre, Paris (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Claire Tabbagh/Collections Numériques)
[14] D’autres panneaux de porte remploient des fragments pourvus de motifs décoratifs différents mais également représentatifs de l’art mamelouk : une porte comportant un décor sculpté rythmé par plusieurs compartiments probablement créés au xixe siècle52 (fig. 6) ; un panneau présentant une décoration en marqueterie à motifs de chevrons (fig. 7) et une partie de panneau de porte qui se compose d’un décor d’assemblage en bois53.
6 Porte en bois, décor sculpté, Proche-Orient arabe (Syrie ou Égypte). Musée du Louvre, Paris (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Claire Tabbagh)
7 Partie de panneau de porte, décor d’assemblage en bois, Proche-Orient arabe, xiiie-xive siècle. Musée du Louvre, Paris (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Claire Tabbagh)
Ces exemples le prouvent, le fragment peut être utilisé dans un but purement décoratif ; il devient alors ornement. Considéré d’un point de vue esthétique comme quelque chose de beau en soi, le fragment perd son référentiel significatif et fonctionnel54. Le remploi transforme donc le fragment qui, d’un objet ancien, devient objet historique. En ce sens, le fragment possède la capacité de transcender le phénomène matériel de sa particularité55. On mesure alors la portée de la métaphore du kaléidoscope dont Lévi-Strauss usait pour évoquer les « arrangements structuraux » que permet cet outil à partir de fragments qui, malgré « la dépossession de leur être propre […] en ont suffisamment pour participer à la formation d’un être d’un nouveau type »56.
[15] L’histoire du goût qui se profile dans la singularité de la collection Saint-Maurice permet de mesurer le retour en faveur de tous les arts décoratifs au xixe siècle, tant du point de vue des procédés de décoration que de la reproduction. Il semble que la sensibilité de Saint-Maurice pour la « beauté intrinsèque des fragments » soit étroitement liée à un intérêt plus large pour les décors historiques modernes et la décoration intérieure. Les dessins, ornements57 et bronzes d’ameublement58 conservés au musée des Arts décoratifs suggèrent en effet une collecte plus « systématique » de la part du collectionneur. Au prisme de cet ensemble de dessins, la collection Saint-Maurice revêt une valeur documentaire, soulignant la volonté du collectionneur de « penser le décor » à travers les siècles. Un dessin légendé « Parquet du Cabinet doré de Monseigneur à Versailles, détruit en 1688 » (fig. 8) est particulièrement intéressant au regard de notre réflexion sur le fragment et l’art du remploi59. Il figure des rinceaux de feuilles d’acanthe accompagnés de vases fleuris entourant le chiffre du roi placé dans un médaillon central.
8 « Parquet du Cabinet doré de Monseigneur à Versailles, détruit en 1688 », xviie siècle, dessin. Musée des Arts décoratifs, Paris (© Les Arts décoratifs, Paris/Jean Tholance)
[16] Ce parquet marqueté avait été commandé à l’ébéniste Pierre Gole en 168260 pour la construction de l’aile du Midi à Versailles qui abritait, au premier étage, les appartements du Dauphin et de la Dauphine61. Le dessin des Arts décoratifs – que l’on peut désormais attribuer à l’ancienne collection Saint-Maurice – est connu des historiens qui se sont intéressés aux décors des appartements du Grand Dauphin à Versailles62. Il permet en effet de restituer les dimensions du Cabinet doré et de confirmer sa situation grâce à l’emplacement de la cheminée et l’ébrasement de la fenêtre. Louis de France63 ne profite que très peu de son appartement du premier étage qu’il doit quitter à la fin de l’année 1683, à la suite du décès de sa mère la reine Marie-Thérèse. Alors qu’il est encore en train de faire décorer les cabinets de son appartement du premier étage, le Dauphin emménage dans les anciens appartements de Monsieur et Madame au rez-de-chaussée64. Il envisage, dans un premier temps, de faire remonter les décors de marqueterie réalisés par Pierre Gole, André-Charles Boulle et Domenico Cucci au premier étage. Cependant, les dimensions des pièces ne permettant aucune adaptation, cette solution est abandonnée. Le Dauphin fait appel aux mêmes artistes pour les décors des cabinets de son appartement du rez-de-chaussée65. Comme l’indique la légende inscrite sur le dessin des Arts décoratifs, les décors du Cabinet doré du premier étage de l’aile du Midi furent démontés en 168866. Qu’est-il advenu du parquet en marqueterie réalisé par Pierre Gole et représenté sur le dessin de la collection Saint-Maurice ? Il n’est pas remployé dans le Cabinet doré ni dans le Cabinet des glaces du rez-de-chaussée, car leurs dimensions ne le permettaient pas. Les historiens doutent que ce décor de marqueterie ait été laissé sans usage après son démontage. Une hypothèse tout à fait plausible a été proposée par Jean-Claude Le Guillou. En 1688, le Dauphin s’intéresse à de petites pièces sans fenêtres qui se situent à l'arrière du Cabinet de marqueterie ou Cabinet des glaces du rez-de-chaussée. Il améliore par exemple son entresol en y ajoutant un escalier et en y réalisant quelques embellissements. Ces pièces sont désignées comme les arrière-cabinets de Monseigneur, elles sont assez exiguës et sombres. Le Guillou relève en effet que les dimensions de ces pièces sont parfaitement identiques à celles du Cabinet de marqueterie de son ancien appartement67. Un article de Jean-Nérée Ronfort appuie l’hypothèse de Le Guillou à propos d’un éventuel remploi du parquet du Cabinet de marqueterie. La découverte d’un document conservé aux Archives nationales a permis d’en savoir davantage sur le devenir des décors du cabinet. Il s’agit de l’inventaire d’un des magasins de la Direction Générale des Bâtiments du Roy à Versailles (c. 1744-1746)68. Ce document fait référence à des éléments de décor d’une « Marqueterie d’ébène verte et d’étain avec plusieurs ornements de bronze doré provenant de l’entresol démolie [sic] de Monseigneur » et d’une « Marqueterie de bois à fleurs ». Malheureusement, les décors de l’appartement du Grand Dauphin disparaissent petit à petit sous Louis XV. Le dessin de la collection Saint-Maurice est donc un document exceptionnel dans la mesure où il renseigne sur l’apparence des décors des appartements du Grand Dauphin à Versailles aujourd’hui disparus. De plus, il renvoie très probablement à un exemple de remploi de décors historiques à Versailles à fin du xviie siècle. Si nous ne pouvons pas dater l’acquisition de ce dessin par Saint-Maurice faute d’archives personnelles, il faut certainement y reconnaître l’intérêt grandissant dans la seconde moitié du xixe siècle pour la collecte de reliques de l’Ancien Régime, au sein de laquelle Versailles occupe une place particulière69.
La dispersion d’une collection
[17] C’est entre 1878 et 1906 que se joue le destin de la collection Saint-Maurice. À son retour d’Égypte en 1878, le collectionneur bâtisseur, qui a dépensé une fortune dans la construction de son hôtel cairote, semble faire face à des difficultés financières70. Entre 1878 et 1893, Saint-Maurice va peu à peu vendre une grande partie de ses collections, en partie auprès de musées, en partie dans le cadre de ventes publiques. Dans un premier temps, c’est sa collection d’objets d’art islamiques, avoisinant le millier d’objets, qui est vendue. Exposée dans la troisième salle de la section égyptienne du palais du Trocadéro à l’Exposition universelle de 187871, elle est finalement achetée par le South Kensington Museum en 1883, à la suite de longues négociations72. La collection reste cependant exposée au palais du Trocadéro entre 1878 et 188373. En 1893, Saint-Maurice négocie avec l’Union centrale des Arts décoratifs (UCAD), cette fois-ci la vente d’un lot de « boiseries arabes » auquel il souhaite adjoindre un lot de bronzes d’ameublement des xviie et xviiie siècles74. Le lot des bronzes modernes est constitué de soixante-treize pièces d’ameublement parmi lesquels dominent ornements de pendule (volutes, feuilles d’acanthe) (fig. 9), tiges de rinceaux, motifs de rocaille, poignées de tiroirs, ornements et appliques de meubles75. Dix ans après l’achat de sa collection d’art islamique par le South Kensington Museum, l’année 1893 marque donc une deuxième étape importante dans la dispersion de la collection Saint-Maurice. En avril 1893, Gaston de Saint-Maurice vend à l’hôtel Drouot une partie de sa collection constituée d’estampes anciennes des écoles française et anglaise, de dessins, d'ornements et de livres76.
9 Ornement de pendule, xviiie siècle, Musée des Arts décoratifs, Paris (© Les Arts décoratifs, Paris/Jean Tholance)
[18] L’étude des œuvres mises en vente par Saint-Maurice nous permet de mieux cerner ses affections dans l’art moderne77. Parmi les estampes anciennes figurent notamment des estampes d’après Huet (singeries), Fragonard, Lavreince, Oudry, Reynolds, Saint-Aubin et Watteau, qui illustrent un penchant répandu dans la seconde moitié du xixe siècle pour la peinture dite « galante ». Les dessins et ornements nous renseignent sur l’inclination de Saint-Maurice pour le décor intérieur et la grammaire ornementale. En effet, il n’est pas anodin de relever des ornements de Boucher (meubles et intérieurs d’appartement), de Boulanger (nouvelles décorations d’appartements), de Cuvilliés (cartouches, plafonds), de Desprez (projet d’un intérieur de galerie), de Pillement, Nicolas Pineau et Ranson (cahier d’ornement pour la boiserie d’appartement), ainsi que des recueils d’ornements et de décors de lambris. Il s’agit d’ailleurs essentiellement de dessins d’études pour plafonds, galeries, portes, frises, modèles de berceaux ou projets de cheminée et trumeaux. Inversement, il est possible d’estimer l’intérêt et la valeur artistiques de cette collection, en s’intéressant aux acheteurs de la vente78. Les marchands d’estampes les plus importants de l’époque font partie de ses acheteurs : Louis Bihn, Paul Prouté et Jules Bouillon79. Le musée des Arts décoratifs figure également parmi les acheteurs. L’institution y acquiert treize dessins des xvie, xviie et xviiie siècles; tous portant sur le décor architectural et des projets de décoration intérieure, on y trouve des projets de berceaux, des éléments de décoration pour plafond, un projet de cheminée et son trumeau, des encadrements de glaces par Richard de Lalonde (fig. 10), un projet de console par Nicolas Pineau (fig. 11), le dessin du parquet de marqueterie du Cabinet doré (fig. 8), six études de cartouches par Stefano della Bella (fig. 12) ainsi que trois projets de décoration pour plafond dont les auteurs sont restés anonymes (fig. 13, 14, 15).
10 Richard de Lalonde (1735-1808), dessin (projet de cheminée et son trumeau), xviiie siècle, plume, encre noire, lavis gris, aquarelle bleue. Paris, Les Arts décoratifs (© Les Arts décoratifs, Paris)
11 Nicolas Pineau (1684-1754), dessin (projet de console), xviiie siècle, sanguine sur papier. Paris, Les Arts décoratifs (© Les Arts décoratifs, Paris)
12 Stefano della Bella, dessin (six études de cartouches), xviie siècle, plume, encre brune. Paris, Les Arts décoratifs (© Les Arts décoratifs, Paris)
13 Anonyme, dessin (projet de plafond), France, xviie siècle, plume et encre brune, aquarelle bleue, jaune, beige, sur preparation à la mine de plomb sur papier. Paris, Les Arts décoratifs (© Les Arts décoratifs, Paris)
14 Anonyme, dessin (projet de décoration pour un plafond), France, xviie siècle, plume, aquarelle et encre brune sur préparation à la mine de plomb. Paris, Les Arts décoratifs (© Les Arts décoratifs, Paris)
15 Anonyme, dessin (projet de fragment de plafond), France, xviie siècle, plume, encre brune, lavis, aquarelle. Paris, Les Arts décoratifs (© Les Arts décoratifs, Paris)
[19] Le catalogue de la vente de 1893 permet également d’étudier la bibliothèque personnelle de Saint-Maurice puisque le collectionneur met en vente ses livres. Trois catégories se dégagent de l’ensemble. La première, relative à l’histoire du goût, des collections et de la curiosité, est illustrée par des ouvrages comme le catalogue des objets de la collection Mariette par Pierre François Basan (1775), le catalogue des collections du musée des Thermes et de l’hôtel de Cluny par Edmond Du Sommerard (1883), les Causeries d’un curieux par Félix Sébastien Feuillet de Conches (1862-1868) ou les Causeries sur l’art et la curiosité d’Edmond Bonnaffé (1878). La deuxième renvoie à la décoration intérieure, à l’ameublement et à l’historiographie des arts industriels. Des ouvrages tels l’Histoire du mobilier d’Albert Jacquemart (1876), l’Histoire des arts industriels au Moyen Âge et à l’époque de la Renaissance par Jules Labarte (1864-1866), L’art à travers les mœurs d’Henri Havard (1882) et Les maîtres ornemanistes par Désiré Guilmard (1880) s’y rattachent. Enfin, une troisième catégorie d’ouvrages représente les domaines de l’architecture et de la grammaire ornementale. On trouve ainsi la Grammaire des arts et du dessin de Charles Blanc (1867), The Grammar of Ornament d’Owen Jones (1856), Des principes de l’architecture de André Félibien (1697), le Livre de l’architecture de Germain Boffrand (1745) ou encore Les arts arabes de Jules Bourgoin (1873) et L’art arabe d’après les monuments du Caire d’Émile Prisse d’Avennes (1877).
[20] Le goût de Saint-Maurice pour les décors historiques à travers le remploi de fragments architecturaux s’inscrit donc bien dans une pratique empreinte d’érudition. Associée à la construction de demeures remployant des décors historiques anciens dans un écrin architectural moderne, la collection de dessins, de recueils d’ornements et d’ouvrages portant sur la décoration intérieure et l’architecture, révèle la volonté du collectionneur de constituer une véritable documentation destinée à penser le décor historique.
[21] Désireux de disposer de nouvelles liquidités financières, Gaston de Saint-Maurice négocie la vente de ses collections auprès de musées d’arts décoratifs, au premier rang desquels figurent le South Kensington Museum et l’UCAD. S’il est désormais possible de rattacher les dessins achetés en 1893 par l’UCAD à la collection Saint-Maurice, dans cette institution, le collectionneur demeure lié à une autre œuvre dont l’histoire fut celle d’une « redécouverte » : le porche mamelouk80. Des réserves du musée des Arts décoratifs à son remploi dans les salles du département des Arts de l’Islam du Louvre, l’histoire muséale de cet ensemble de quelques trois cents pierres sculptées est désormais bien connue81. L’acheminement par bateau depuis Le Caire des vingt-cinq caisses contenant les pierres du porche est en effet documenté grâce aux lettres échangées entre l’architecte Charles Guimbard et le secrétaire général de l’UCAD82. D’après ces documents, Guimbard, qui avait été chargé de la construction de l’hôtel Saint-Maurice au Caire, traite directement avec l’UCAD83. Saint-Maurice semble en effet peu engagé dans la gestion du transport des caisses. Une lettre du secrétaire général de l’UCAD adressée à Saint-Maurice et datée du 11 juillet 1888 nous apprend que le collectionneur possédait des croquis du porche que l’UCAD souhaitait se procurer afin de pouvoir procéder au remontage le moment venu84. Ces croquis, retrouvés dans les archives de l’UCAD, avaient été à cette époque perdus de vue85. La provenance de cet ensemble ne fait aucun doute puisqu’il est désigné dans les documents d’archives comme « porte arabe » et y est toujours associé à Gaston de Saint-Maurice. En revanche, le statut de son entrée dans les collections de l’UCAD semble plus flou. Inventorié comme un don de Gaston de Saint-Maurice depuis la régularisation d’inventaire en 2003 et cité comme tel dans les diverses publications, le porche mamelouk ne figure pourtant sur aucun ancien registre d’inventaire des Arts décoratifs86. Quelques documents renvoient au porche comme à un don, mais aucun d’entre eux n’émane directement de Saint-Maurice. Annie-Christine Daskalakis Mathews affirme que l’on perd toute trace des caisses après leur mention dans une lettre datée du 27 mars 188987. Or, deux documents plus tardifs suggèrent a contrario que Saint-Maurice souhaitait vendre cet ensemble architectural à l’UCAD. Tout d’abord, la « porte arabe » apparaît sur l’Ordre du jour d’une séance de la Commission du musée datée du 26 décembre 1900. Elle est classée dans les propositions d’achat au nom de M. de Saint-Maurice et évaluée au prix de 1500 francs88. Le brouillon d’une lettre de réponse de Louis Metman à Saint-Maurice nous apprend que l’UCAD, après avoir un temps songé à remonter pour son compte le porche, a refusé la proposition d’achat du collectionneur89. Au regard de ces documents inédits, il convient certainement de nuancer l’idée d’un don de la part de Saint-Maurice. En effet, Saint-Maurice ne fut pas un donateur auprès des musées. Sa pratique de la collection et son intérêt pour les arts décoratifs et les constructions architecturales historicistes ne traduisent pas la démarche d’un collectionneur en quête de distinction sociale.
[22] Une dernière vente aux enchères achève la dispersion de sa collection après sa mort90. Cette vente, organisée en 1906 par ses deux sœurs et héritières91, fut dirigée par Paul Chevallier92. La variété des objets qui composent cette vente témoigne de l’étendue de la collection Saint-Maurice. Le collectionneur possédait des tableaux des écoles française, italienne et flamande, ainsi que des gravures d’après Boilly, Chardin ou Fragonard. Sa collection de céramique était également importante puisqu’elle contenait des porcelaines du Japon, de Chine, de Saxe, de Sèvres et de Wedgwood, et des faïences de Kutaïa. Dans la section dite des objets variés on note plus particulièrement un lot de boiseries orientales et un fragment d’architecture gothique. Divers lots de bronzes, d’appliques, de flambeaux et de fragments de céramique sont également mis aux enchères93. Les principaux acheteurs furent Metman, Féral, Bihn, Mannheim, Rouveyre, Foulc ou encore la baronne de Günzburg.
[23] La collection Saint-Maurice témoigne du goût pour le remploi de décors historiques dans la seconde moitié du xixe siècle. Mise en œuvre dans la réalisation de projets architecturaux, cette pratique illustre un véritable art de la reprise dont les collectionneurs, en grande partie aristocrates, sont les commanditaires. Saisissant les opportunités d’un marché de l’art façonné par les démolitions de demeures et édifices historiques, Saint-Maurice collectionne et remploie, parfois en les modifiant, des fragments de décors dans une architecture moderne. Néanmoins, le désir d’appropriation de ces fragments par le collectionneur bâtisseur est plus intéressant à souligner que la disponibilité des pièces elles-mêmes94. Il inspire, ainsi que nous avons pu le voir, différentes réalisations. Dans la seconde moitié du xixe siècle, le goût pour les reliques du passé et la récupération de décors anciens se manifeste davantage chez les collectionneurs aristocrates, qui accumulent des objets pour reconstituer, restaurer ce qui n’est plus95. Il s’agit bien d’un art de la reprise, qui repose sur une véritable industrie du recyclage et implique des compétences pour reconstituer et redonner vie à des décors anciens. À l’image du dandy, figure aux multiples facettes, la collection Saint-Maurice, qui s’étend de l’art mamelouk égyptien à l’art du xviiie siècle, conserve les traces d’un rapport singulier à l’art, au passé et à l’architecture, intimement lié à la volonté de penser le décor.
Local Editor Anne-Laure Brisac-Chraïbi, Institut national d'histoire de l'art, Paris
Reviewers Philippe Thiebaut
License
The text of this article is provided under the terms of the
Creative
Commons License CC-BY-NC-ND 4.0
1 Jacques-Émile Blanche, Mes modèles. Souvenirs littéraires, 5e éd., Paris 1929, 120-121.
2 James Tissot, Le Cercle de la rue Royale, 1868, huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris. Commandée en 1868, l’œuvre avait été financée à parts égales (à hauteur de 1.000 francs) par les douze personnages représentés. Le baron Hottinger (1835-1920) devint propriétaire du tableau par tirage au sort. Voir Xavier Rey, « Le Cercle de la rue Royale (1868) de James Tissot », in : La Revue des musées de France. Revue du Louvre 5 (2011), 21-22.
3 Archives municipales de Compiègne, État civil, « Registre des naissances, adoptions, mariages et décès des citoyens de la commune de Compiègne, An 1831 », Acte n° 215.
4 Général de Séroux, « La famille Jouenne d’Esgrigny à Compiègne », in : Bulletin de la Société historique de Compiègne 18 (1926), 1-65, ici : 16-17. La branche Esmangart de Bournonville de Saint-Maurice s’éteint avec Charles Gaston.
5 Charles-Victor Ansart, Notice généalogique sur la famille de Esmangard (Normandie et Beauvaisie), Clermont-de-l’Oise 1952, 19-20.
6 Jean-Baptiste-Louis-Georges Séroux d’Agincourt, Histoire de l’art par les monumens, de sa décadence au ive siècle jusqu’à son renouvellement au xive siècle, 6 vols., Paris 1823.
7 Pour ne citer qu’eux : Jean Esmangart de Bournonville (1768-1849) fut administrateur du Bureau de bienfaisance. Son frère, François-de-Sales Esmangart de Bournonville de Saint-Maurice (1769-1851), fut adjoint au maire de Compiègne sous la Restauration.
8 Archives du musée national du château de Compiègne, Registre de correspondance 1832-1834, p. 50. Le roi Léopold Ier épouse le 9 août 1832 à Compiègne Louise d’Orléans, fille du roi Louis-Philippe. Voir Joseph-Désiré Court, Mariage de Léopold Ier, roi des Belges, et de Louise d’Orléans, le 9 août 1832, 1832, huile sur toile, musée national du château de Compiègne, Compiègne, 91DE583 / MV 5122.
9 Les « Compiègne » commencent véritablement en 1856, date à partir de laquelle la cour impériale séjourne environ un mois par an au château et s’instaure également l’organisation des invitations en « séries ». Le dernier séjour de la cour impériale à Compiègne eut lieu en 1869.
10 Conservées à la bibliothèque des Arts décoratifs à Paris, les archives de l’Union centrale des Arts décoratifs (UCAD) attestent qu’il réside à cette adresse à son retour de l’Égypte en 1878. À cette époque, l’Ouest parisien est en effet très prisé par l’aristocratie et la haute bourgeoisie.
11 Archives de Paris, Enregistrement, DQ73 1693, « Déclaration de mutation par décès de Charles Gaston Esmangart de Bournonville de Saint-Maurice, 8 décembre 1905 », quittance n° 279 : « Propriété sise à Dieppe, dans le périmètre de la ville, sur le bord de la route de Pourville, connue sous le nom de Pré Saint-Nicolas, consistant en : Article 1er - Maison de Maître, genre villa, serre, écurie et remise, communs et dépendance, grand terrain en nature de jardin, pièce d’eau, bosquet, charmille, terrasse, prairie, herbage et falaise, d’une contenance totale de 20.102 m². Article 2e - Un grand terrain en nature de prairie en face de la propriété ci-dessus désignée, de l’autre côté de la route de Dieppe à Pourville, d’une contenance de un hectare, le dit terrain non planté. »
12 Viviane Manase, « Les villégiatures familiales de la côte d’Albâtre (du Tréport au Havre) », in : In Situ. Revues des patrimoines [en ligne], 13 | 2010, URL : http://insitu.revues.org/6966; DOI : 10.4000/insitu.6966 (consulté le 24 novembre 2014).
13 Jacques de Günzburg ou Gunzbourg (1853-1929) était un homme d’affaires et un banquier d’origine russe.
14 Archives de Paris, Enregistrement, « Déclaration complémentaire du 29 mai 1906. 7e bureau, n° 811, Succession Saint-Maurice ». Ces éléments consistent en un lot de démolitions comportant notamment portes et châssis, vendu aux enchères le 10 avril 1906. Le prix net s’est élevé à 223,35 francs.
15 Mercedes Volait, Fous du Caire : excentriques, architectes et amateurs d’art en Égypte, 1863-1914, Montpellier 2009. Voir également du même auteur : Maisons de France au Caire : le remploi de grands décors mamelouks et ottomans dans une architecture moderne, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2012 ; « Amateurs français et dynamique patrimoniale : aux origines du Comité de conservation des monuments de l’art arabe », in : La France et l’Égypte à l’époque des vice-rois (1802-1805), éd. André Raymond et Daniel Panzac, Le Caire 2002, 311-325 ; et « Passions françaises pour l’art mamelouk et ottoman du Caire (1867-1889) », in : Purs décors ? Arts de l’Islam, regards du xixe siècle, cat. exp., Paris, Musée des Arts décoratifs, 2007, 98-103.
16 La redécouverte de l’Égypte médiévale et de la dynastie mamelouke en particulier est due à des amateurs français. Voir Mercedes Volait, éd., Émile Prisse d’Avennes. Un artiste-antiquaire en Égypte au xixe siècle, Le Caire 2013.
17 Les plus emblématiques furent Arthur-Ali Rhoné (1836-1910), le baron Alphonse Delort de Gléon (1843-1899) et Ambroise Baudry (1838-1906). Voir Mercedes Volait, « Arthur-Ali Rhoné (1836-1910) », in : Socio-anthropologie [en ligne], 19 | 2006 [mis en ligne le 31 octobre 2007], URL : http://socio-anthropologie.revues.org/543 (consulté le 3 décembre 2014).
18 Mercedes Volait, « Le remploi de grands décors historiques dans l’architecture moderne : l’hôtel particulier Saint-Maurice au Caire (1875-1879) », in : 5esRencontres internationales du patrimoine architectural méditerranéen, éd. Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine, Marseille 2013, 109-112.
19 Mercedes Volait, « Dans l’intimité des objets et des monuments : l’orientalisme architectural vu d’Égypte (1870-1910) », in : L’orientalisme architectural entre imaginaires et savoirs, éd. Nabila Oulebsir et Mercedes Volait, Paris 2009 [mis en ligne en octobre 2011 : http://inha.revues.org/3348 (consulté le 26 septembre 2014)].
20 Ces recherches ont été menées dans le cadre d’un stage au sein de l’USR 3103 InVisu (CNRS/INHA) en 2014. Elles ont notamment permis d’identifier plusieurs dessins conservés au Cabinet des Arts graphiques du musée des Arts décoratifs, Paris, comme provenant de la collection Saint-Maurice. Nous souhaitons ici remercier Mercedes Volait ainsi que l’ensemble de l’équipe de l’USR 3103 InVisu pour son accueil.
21 Certaines de ces œuvres (celles conservées au Louvre notamment) ont fait l’objet d’une étude scientifique. Leur origine suscite encore des questionnements de la part des conservateurs qui proposent généralement une origine égyptienne ou syrienne. Achetés par le musée des Arts décoratifs en 1893, ces objets ont été transférés au département des Arts de l’Islam du Louvre.
22 Cette idée est développée par Ruth Fiori, Paris déplacé, du xviiie siècle à nos jours : architectures, fontaines, statues, décors, Paris 2011, 6.
23 Volait, Fous du Caire, voir notamment le chapitre II : « Amateurs et collectionneurs d’art islamique : galerie de portraits », 67-115. Comme le souligne l’auteur, il est souvent difficile de dater les prémices de la formation d’une collection. En 1871, Saint-Maurice obtient la concession d’un terrain dans le quartier d’Ismâ’îliyya où il fait construire son hôtel particulier. L’aménagement et les décors de cette demeure conçue par Ambroise Baudry bénéficient de l’affluence sur le marché de nombreux objets et fragments d’architecture issus des chantiers de destruction du Caire médiéval.
24 Arjun Appadurai, éd., The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, London/New York 1986.
25 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris 1962, 51. Lévi-Strauss introduit une homologie structurelle avec le kaléidoscope. Selon lui, les éléments sont issus d’un processus de destruction et de cassure : « [les fragments] n’ont plus d’être propre, par rapport aux objets manufacturés qui parlaient un ‹ discours › dont ils sont devenus les indéfinissables débris ; mais sous un autre rapport, ils doivent en avoir suffisamment pour participer utilement à la formation d’un être d’un nouveau type. Le tout forme une structure, bornée par les limites du kaléidoscope, ou structure du système signifiant ; la combinaison particulière que prend le tout est contingente, résultant de la giration du kaléidoscope par l’observateur ou de certaines associations entre des oppositions différentielles : la combinaison ainsi formée est projetée sur les choses, et n’est pas en elle-même objet d’une expérience pour l’observateur. »
26 « Kaléidoscope », in : Le Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 2e éd., tome V, Paris 1988, 877 : « Petit instrument cylindrique, dont le fond est occupé par des fragments mobiles de verre colorié qui, en se réfléchissant sur un jeu de miroirs angulaires disposés tout au long du cylindre, y produisent d’infinies combinaisons d’images aux multiples couleurs. »
27 Marie-Laure Crosnier-Leconte et Mercedes Volait, éd., L’Égypte d’un architecte : Ambroise Baudry (1838-1906), Paris 1998, 79-85 ; Volait, Maisons de France au Caire, 33-37. La construction de l’hôtel est réalisée par les architectes Charles Guimbard et Marcel Gouron-Boisvert entre 1871 et 1879.
28 Les destructions favorisent alors l’émergence d’un marché dont les intermédiaires, marchands et antiquaires, se fournissent sur les chantiers de démolition. Si Saint-Maurice pouvait avoir accès à ces chantiers, il a vraisemblablement acheté la majeure partie des objets auprès de marchands.
29 Volait, Fous du Caire, 98. Certains matériaux sont en effet remontés en de savants assemblages mêlant des fragments médiévaux à des copies ou pastiches du xixe siècle.
30 Les archives du musée des Arts décoratifs permettent en effet de remonter jusqu’en 1865 pour attester de l’existence et de la composition (certes non exhaustive) de cette collection. Comme c’est le cas pour de nombreuses études sur les collections et les collectionneurs, les archives muséales permettent souvent de pallier l’absence d’archives privées (correspondances, registres d’achat etc.).
31 Cette pratique de la collection, tournée vers l’architecture, les fragments de décors et les objets d’art, témoigne d’un réel intérêt pour l’héritage architectural et ornemental de l’Égypte médiévale. Voir Volait, « Passions françaises pour l’art mamelouk et ottoman du Caire (1867-1889) », 98-103.
32 Archives du musée des Arts décoratifs (AAD), Enregistrement des objets confiés au Musée rétrospectif (1865), A1/69, « Livre d’enregistrement des prêts ». Saint-Maurice prête 51 objets parmi lesquels des bijoux antiques (n° 170 et 205), un coffret d’ivoire médiéval en forme de reliquaire à ornements sculptés (n° 356), un meuble à deux corps avec incrustations d’ivoire blanc sur ivoire noir (n° 1044), un cabinet en bois d’ébène avec incrustations d’argent gravé représentant des scènes militaires (France, début du xviie siècle, n° 1047, estimé à 6000 francs), mais aussi des bronzes d’ameublement comme une paire de flambeaux en forme de vase sur un socle (xviiie siècle, n° 3793) ou deux petits candélabres à trois branches en bronze doré, montés sur bouteille en chine bleu d’époque Louis XVI (n° 3800). On note également parmi les objets appartenant à Saint-Maurice une « aiguière orientale (Perse) et son bassin ». Voir Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie. Exposition de 1865. Palais de l’industrie. Musée rétrospectif, Paris 1867. Nous signalons ici les recherches menées en 2015 par María José Jarrín au sein de l’USR 3103 InVisu (CNRS/INHA) et consacrées à l’iconographie de la collection Saint-Maurice à Paris (1865-1884).
33 AAD, Exposition universelle de 1878, A2/18, « Comité directeur ».
34 AAD, Acquisitions faites par le musée des Arts décoratifs (1893), C2/17, « Résumé par classes des acquisitions faites par le musée des Arts décoratifs pendant le 2e semestre de l’année 1893 ». Les achats à Saint-Maurice portent les n° 7671 à 7681 « Onze panneaux en marqueterie de bois sculpté d’os et de nacre » et les nos 7682 à 7730 « Soixante-treize pièces diverses bronzes d’ameublement des xviie et xviiie siècles. »
35 AAD, Expositions organisées au Pavillon de Marsan, D1/31, « Les Arts musulmans : Tableau alphabétique des participants, carnets de réception, correspondance, compte général, valeurs d’assurance ». Voir également Union centrale des Arts Décoratifs. Pavillon de Marsan. Exposition des Arts Musulmans. Catalogue descriptif par M. Gaston Migeon, M. Max van Berchem et M. Huart, Paris 1903. Les trois objets prêtés par Saint-Maurice sont : un fragment de brique portant un fragment d’inscription gravé, dont le contour en caractères coufiques est émaillé en bleu turquoise (provenant de la frise de la coupole de la mosquée du Sultan Hassan, Égypte, xve siècle, n° 339, 48) ; un tissu à bandes chevronnées vertes, lisérées en rouge avec inscription (Asie Mineure, xvie siècle, n° 718, p. 93) ; une boîte de Coran en cuir repoussé et ciselé, à décors d’entrelacs fleuris avec une bande d’inscription sur la partie supérieure (Égypte, xvie siècle, n° 938, p. 119).
36 Catalogue d’estampes anciennes des écoles française et anglaise du xviiie siècle, ornements, dessins, par Fragonard, Saint-Aubin, très beaux documents relatifs à la décoration par des artistes du xviie et du xviiie siècle, livres relatifs aux beaux-arts, provenant de la collection de M. de S.-M*** dont la vente aux enchères publiques aura lieu Hôtel des Commissaires-priseurs, rue Drouot, 9, salle n° 10, les lundi 10 et mardi 11 avril 1893. La vente fut dirigée par Maurice Delestre, commissaire-priseur, et Jules Bouillon, expert et marchand d’estampes de la Bibliothèque nationale.
37 Catalogue des objets d’art et d’ameublement, faïences et porcelaines, objets variés, sculptures, bronzes, pendules, sièges et meubles, étoffes, tableaux anciens et modernes, primitifs de l’école italienne, aquarelles, dessins, gravures des écoles française et anglaise du xviiie siècle, livres, composant la collection de feu M. Gaston de Saint-Maurice, et dont la vente, par suite de son décès, aura lieu, à Paris, Hôtel Drouot, salle n° 6, les lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 mars 1906. La vente fut dirigée par Paul Chevallier.
38 Bruno Pons, Grands décors français, 1650-1800 : reconstitués en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en France, Dijon 1995. Cet ouvrage fondateur contribua à créer un nouvel intérêt érudit centré sur le remploi des décors historiques en lien étroit avec le connoisseurship. Le souci de produire des travaux sur les vies des décors et des objets apporta de précieux éclairages sur les conséquences matérielles de ces reconstitutions. Voir plus particulièrement les chapitres intitulés « Considération pour la beauté intrinsèque des fragments du xviiie siècle », 39-40, et « Les collectionneurs de fragments », 46-47.
39 Le phénomène connaît une existence particulièrement effervescente aux États-Unis.
40 Ce commerce a été étudié par Bruno Pons pour le xviiie siècle, en particulier en ce qui concerne les boiseries vendues à la suite des démolitions de châteaux, hôtels ou immeubles. Les fragments, matériaux et éléments de décors commençaient à être collectionnés pour eux-mêmes. Nous renvoyons également à l’intéressante recherche de Thomas Deshayes, Collectionner les boiseries anciennes françaises : marché, marchands et collectionneurs (1848-1939), Mémoire de recherche, Paris, École du Louvre, 2012. Pour ce qui est du Caire à la même époque, si quelques architectes et collectionneurs français permettent d’étudier le phénomène de plus près, il est encore difficile de cerner les acteurs, marchands et antiquaires d’une part, artisans et professionnels du remontage de ces décors d’autre part.
41 Volait, Maisons de France au Caire, 49-69. De nombreuses photographies illustrent l’usage du remploi fait in situ par Saint-Maurice dans son hôtel particulier.
42 Cet objet a été restauré et étudié en 2007 à l’occasion de l’exposition Purs décors ? Arts de l'Islam, regards du xixe siècle, ed. Rémi Labrusse, cat. exp., Paris 2007. Il est particulièrement intéressant de constater que pendant la restauration, le Louvre a décidé de désolidariser la partie centrale, d’époque médiévale de son encadrement en bois daté du xixe siècle. L’œuvre est à présent exposée sans cet encadrement dans les salles du département des Arts de l’Islam. Ces objets de remploi, au caractère profondément hybride, posent des problèmes de catégorisation dans un espace muséal dont la muséographique est pensée et articulée par aires géographiques et chronologiques.
43 Ces éléments descriptifs sont issus du dossier d’œuvre conservé au service de la documentation du département des Arts de l’Islam du Louvre. Les dossiers d’œuvres contiennent également les rapports de restauration des œuvres (lorsque celle-ci a été réalisée). Nous tenons à remercier le personnel de la documentation du département des Arts de l’Islam pour son accueil et sa disponibilité.
44 D’anciennes réintégrations en bois, os ou ivoire étaient visibles à la périphérie du panneau central ; elles ont été supprimées au cours de la restauration en 2007.
45 Le minbar est une chaire à prêcher de la mosquée, en bois ou en pierre, mobile ou fixe.
46 Panneau d’encadrement en bois avec un décor assemblé d’os et de nacre, Proche-Orient arabe/Égypte, s. d., Musée du Louvre, AD7675. En dépit de sa restauration en 2009, aucune datation n’est proposée pour cet objet. Le rapport de restauration est consultable au service de la documentation du département des Arts de l’Islam.
47 Boiserie avec inscription tirée de la Sourate 7, verset 21, Égypte, xive siècle. Musée du Louvre, Paris, AD768.
48 Dale Kinney, « Introduction », in : Richard Brilliant et Dale Kinney (éd.), Reuse Value. Spolia and Appropriation in Art and Architecture from Constantine to Sherrie Levine, Farnham 2011, 1-11.
49 Jacqueline Lichtenstein, « The Fragment: Elements of a Definition », in : William Tronzo, éd., The Fragment. An Incomplete History, Los Angeles 2009, 115-129. Il est intéressant de souligner que le remploi a toujours été une pratique fréquente dans les arts de l’Islam, notamment dans l’art mamelouk. Voir le dossier coordonné par Mercedes Volait, « Ces musées arabes qui refont l’histoire », in : Quantara. Magazine des cultures arabe et méditerranéenne 96 (juillet 2015), 27-60.
50 Kinney, Reuse Value, 1-11.
51 Partie de panneau de porte, Proche-Orient arabe/Égypte, xiiie-xive siècle, bois, décor d’assemblage (bois et os). Musée du Louvre, AD7676. Des exemplaires similaires sont conservés au Victoria and Albert Museum, leur état de conservation est en général bien meilleur. Une intéressante photographie conservée dans ce même musée montre des panneaux semblables, disposés derrière l’étalage d’un marchand de cuivres au Caire à la fin du xixe siècle : Gabriel Lekegian, Magasin d’un marchand de cuivres arabes, fin du xixe siècle, tirage sur papier albuminé, Victoria and Albert Museum, Londres, PH 1414-1896. Nous remercions Mercedes Volait de nous avoir signalé l’existence de cette photographie.
52 Porte en bois, décor sculpté, Proche-Orient arabe (Syrie ou Égypte). Musée du Louvre, AD7671.
53 Partie de panneau de porte, décor d’assemblage en bois, Proche-Orient arabe, xiiie-xive siècle. Musée du Louvre, Paris, AD7672a.
54 Lichtenstein, « The Fragment: Elements of a Definition », 115-129.
55 William Tronzo, « The Cortile delle Statue: Collecting Fragments, Inducing Images », in : William Tronzo, éd., The Fragment. An Incomplete History, Los Angeles 2009, 39-60.
56 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, voir note 23.
57 AAD, Séances de la Commission du musée, C1/98, « Acquisitions décidées par la Commission du musée, d’accord avec la Commission des Finances. 15 avril 1893 ». Un dépouillement attentif des archives de l’UCAD a permis de rétablir leur provenance. Ces dessins ont été achetés en 1893 en vente publique, la même année que les boiseries et les bronzes d’ameublement (précisément deux semaines avant). Ils sont donc intéressants à plusieurs niveaux : d’une part, leur choix par le musée est significatif ; d’autre part, cette vente d’estampes, dessins et ornements de la collection Saint-Maurice nous renseigne sur tout un pan encore inexploré de celle-ci.
58 AAD, Séances de la Commission du musée, C1/98, « Acquisitions décidées par la Commission du musée d’accord avec la Commission des Finances. 29 avril 1893 ». Les bronzes d’ameublement d’époque moderne ont été achetés en 1893 avec le lot de boiseries. L’ensemble est acquis par l’UCAD à un prix s’élevant à 7.150 francs. Les bronzes d’ameublement étaient estimés à 1.000 francs. Saint-Maurice avait dans un premier temps fait évaluer les boiseries par Ambroise Baudry mais l’UCAD ne souhaitait pas avoir recours à un tiers pour mener ses négociations. Voir AAD, Commission du musée (1891-1900), C1/41, « Séance du 22 avril 1893 » : « Sur les rapports de MM. Gasnault, Dreyfus et Maciet qui ont été examiner les boiseries orientales proposées par M. de Saint-Maurice, la commission autorise M. Gasnault à négocier l’acquisition des plus intéressantes dans la limite d’un crédit de 7.000 francs, en y comprenant un lot de bronzes du xviie et xviiie siècle. »
59 Musée des Arts décoratifs, Paris, inv. 7613. La légende ancienne sur le dessin précise : « Dessin du parquet de marqueterie du Cabinet doré de Monseigneur dans l’entresolle de la Grande Aisle Démoly en février 1688. »
60 Pierre Gole (1620-1685), ébéniste hollandais installé à Paris vers 1643. Devenu ébéniste du roi Louis XIV, il fut, dès 1650, l’un des grands propagateurs de l’utilisation du décor de marqueterie florale. Voir Christophe Huchet de Quénetain, « Pierre Gole », in : L’Estampille - L’Objet d’art 19, no 416 (2006), 27-28 ; Theodoor Herman Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole : ébéniste de Louis XIV, Dijon 2005, p. 216, fig. 169; le dessin est attribué par l’auteur à Pierre Gole.
61 L’aile du Midi fut construite entre 1678 et 1685. Installées au premier étage et ouvrant sur les jardins, les pièces principales étaient doublées d’une série de petites pièces, certaines prenant le jour par la galerie donnant sur la cour, d’autres situées en entresol. Parmi ses dernières figuraient un Cabinet doré et un Cabinet des glaces qu’il faut peut-être confondre. C’est pour ce cabinet que Pierre Gole achève à la fin de l’année 1682 un parquet de marqueterie de bois dont les dimensions étaient de 3,60 m sur 2,90 m. Presque rien n’est connu de cet appartement dont aucun plan n’a survécu. Voir Jean-Nérée Ronfort, « André-Charles Boulle. Commandes pour le Grand Dauphin à Versailles », in : Dossier de l’art 13, n° 124 (2005), 38-65. À la mort de Pierre Gole en 1685, André-Charles Boulle poursuit les décors de l’appartement du Dauphin.
62 Le dessin a notamment été présenté en 1932 à l’exposition L’Art de Versailles, musée de l’Orangerie, Paris, et reproduit plusieurs fois dans : Alfred Marie et Jeanne Marie, Mansart à Versailles, Paris 1972, vol. I, 267 ; Stéphane Castelluccio, « La collection de vases en pierres dures du Grand Dauphin », in : Versalia 4 (2001), 51 ; et Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV, 216.
63 Louis de France (Fontainebleau 1661 - Meudon 1711), dit Monseigneur, ou le Grand Dauphin après sa mort.
64 Jean-Jacques Gautier, « Les occupants du premier étage de l’aile du Midi à Versailles sous Louis XIV », in : Versalia 14, no 14 (2011), 63-92.
65 Il est intéressant de souligner que les cabinets du Dauphin étaient destinés à l’exposition de ses collections. Il attachait donc un intérêt particulier aux décors de ces pièces. Voir Castelluccio, « La collection de vases en pierres dures du Grand Dauphin », 50-54.
66 Comme l’attestent les Comptes des Bâtiments du roi sous Louis XIV publiés par Jules Guiffrey en 1881, c’est le miroitier Briot qui procède au démontage. Voir Gautier, « Les occupants du premier étage de l’aile du Midi », 70.
67 Jean-Claude Le Guillou, « L’appartement de Monseigneur et de ses fils au château de Versailles. Évolutionchronologique, 1684-1715 », in : Robert P. Maccubbin et David F. Morrill, éd., The Art and Architecture of Versailles. Papers Presented at The Versailles Colloquium – 1985, Baltimore 1993, 68-85, voir 71 : « Il est possible, mais cela n’est pas prouvé, que l’on ait remonté à ce même moment, dans un second cabinet d’entresol, le fastueux décor de marqueterie de l’ancien cabinet de Monseigneur dans l’aile du Midi. Il se trouve en effet que c’est précisément en 1688, lorsque Monseigneur aménageait son entresol du corps de château que l’on démontait celui de l’aile du Midi. Les dimensions des pièces s’accordent si parfaitement que l’on peut y songer. Mais en l’absence de preuve, nous ne pouvons que remarquer la coïncidence. »
68 Archives nationales (A.N.), Paris, Maison du Roi, O1 1532-164. Le document est reproduit dans Ronfort, « André-Charles Boulle. Commandes pour le Grand Dauphin à Versailles », 64-65.
69 Des publications de plus en plus nombreuses d’amateurs et d’érudits qui se passionnent pour le destin des collections royales (que les ventes à l’issue des saisies révolutionnaires avaient dispersées sur le marché de l’art) témoignent de ce phénomène. Ces érudits commencèrent à consulter des archives relativement récentes, permettant de rapprocher les œuvres d’une documentation de plus en plus foisonnante. Parmi ces érudits il faut citer Louis Courajod, Jules Guiffrey, le baron Charles Davillier (La vente du mobilier du château de Versailles pendant la Terreur : Documents inédits, Paris 1877), Alfred de Champeaux (Portefeuille des arts décoratifs, Paris 1892), Henri Havard, Émile Molinier et d’autres, qui furent les pionniers d’une discipline nouvelle. Voir Christian Baulez, « Le remeublement de Versailles. Histoire du goût et goût de l’histoire », in : De Versailles à Paris. Le destin des collections royales, éd. Jacques Charles, cat. exp., Paris, Centre culturel du Panthéon, Paris 1989, 195-208.
70 Il faut en effet souligner que les constructions de demeures architecturales historicistes sont très coûteuses. Il n’y a guère que les Rothschild qui ont pu bâtir de grandes demeures historicistes, avec un goût tourné vers l’art du xviiie siècle, les conserver sur plusieurs générations ou les donner à la nation. Voir Pauline Prévost-Marcilhacy, Les Rothschild : bâtisseurs et mécènes, Paris 1995. De plus, si l’on prend en considération le mode de vie fastueux du dandy aristocrate, on peut aisément en déduire l’origine des difficultés financières du comte de Saint-Maurice.
71 L’Exposition en poche. Guide pratique illustré par Uzès, Paris 1878, 167. La troisième salle est intitulée « L’Égypte des Khalifes ».
72 La collection est achetée au prix de 2.000 livres alors que le collectionneur en demandait 4.000. Sur l’achat de la collection Saint-Maurice par le South Kensington Museum, voir Volait, « Amateurs français et dynamique patrimoniale », 317, note 36, et Annie-Christine Daskalakis Mathews, « Un amateur d’architecture mamelouke au Caire : le comte de Saint-Maurice », in : Purs décors ? Arts de l'Islam, regards du xixe siècle, 104-105.
73 AAD, Constitution de la Société du musée des Arts décoratifs, A2/18, « Comité directeur. Séance du 25 novembre 1878 ». Près de deux cent objets sont exposés au palais du Trocadéro. Deux documents conservés dans les archives de l’UCAD soutiennent en effet l’idée d’une exposition de la collection durant cette période et nous renseignent sur les types d’objets exposés. Une note renvoie à l’enlèvement des objets par le musée au domicile de Saint-Maurice 12, rue de Penthièvre. Il s’agit de « cuivres, tapis, bijoux, fenêtres, vitraux, moucharabieh, plafonds et moulages, boiseries, collection de faïences arabes et persanes ». Cette note atteste aussi de l’autorisation donnée par Saint-Maurice de reproduire par la photographie ou le dessin les œuvres. En revanche le collectionneur n’autorise aucun moulage. Une seconde lettre datée du 19 février 1883 et intitulée « Liste des objets enlevés au musée des Arts décoratifs. Collection de M. de Saint-Maurice » offre une liste plus détaillée des objets au moment de l’achat par le musée de South Kensington. Voir AAD, Prêts pour des expositions temporaires, B2/9, « Expositions particulières. Objets prêtés par des amateurs ».
74 AAD, Commission du musée, Procès-verbaux du 14 février 1891 au 21 novembre 1900, C1/41, « Séance du 22 avril 1893 ». La commission autorise l’achat des boiseries arabes et des bronzes d’ameublement de la collection Saint-Maurice dans la limite d’un crédit de 7.000 francs. Les deux lots sont achetés à 7.150 francs contre les 8.690 francs demandés par Saint-Maurice. À titre de comparaison, comme en témoigne le procès-verbal de cette même séance, la commission accorde un crédit de 40.000 francs en prévision de la vente de la collection Spitzer.
75 AAD, Acquisitions faites par le musée des Arts décoratifs, 1893, C2/17, « Résumé par classes des acquisitions faites par le musée des Arts décoratifs pendant le 2e semestre de l’année 1893 : n° 7682 à 7730, soixante-treize pièces diverses, bronze d’ameublement des xviie et xviiie siècles ».
76 Acquisitions décidées par la Commission du musée d’accord avec la Commission des finances, C1/98, « Séance du 15 avril 1893 ». À partir d’un document retrouvé dans les archives de l’UCAD faisant référence à l’achat de dessins lors d’une vente dite « Saint-Maurice », nous avons retrouvé le catalogue de la vente en question et dépouillé les archives des commissaires-priseurs déposées aux Archives de Paris afin de retrouver le procès-verbal de cette vente pour s’assurer que le vendeur était bien Gaston de Saint-Maurice. Le document en question, très précieux, fournit le nom des acheteurs et les prix auxquels les objets ont été vendus. En croisant les informations contenues dans le catalogue de vente à celles du procès-verbal, nous pouvons ainsi reconstituer une partie importante de la collection Saint-Maurice jusqu’alors ignorée.
77 Catalogue d’estampes anciennes, 1893. La vente fut dirigée par Maurice Delestre, commissaire-priseur, et Jules Bouillon, expert et marchand d’estampes de la Bibliothèque nationale. Le produit de la vente s’est élevé à 15.163,50 francs.
78 Archives de Paris, Archives des Commissaires-priseurs, Étude de Me Maurice Delestre, D60E3 59, « Procès-verbal de la vente Saint-Maurice des 10 et 11 avril 1893 ».
79 Frédéric Poulard, « Marchands d’estampes à Paris : statuts et jugement esthétique », in : Ethnologie française 35/1 (2005), 73-80. Henri et Louis Bihn étaient marchands d’estampes anciennes et encadreurs, Paul Prouté possédait une galerie (qui existe toujours) spécialisée dans la vente de dessins et d’estampes, et Jules Bouillon, expert de la vente Saint-Maurice, vendait de nombreuses œuvres à la Bibliothèque nationale.
80 Revêtement décoratif d’un porche d’honneur ornant l’entrée d’un édifice civil de prestige et caractéristique de l’art mamelouk.
81 Inventorié rétrospectivement en 2003 (RI 2003.26), le porche mamelouk était resté en caisses depuis son arrivée au musée des Arts décoratifs en 1889. Annie-Christine Daskalakis Mathews, Le porche mamlouk, Paris 2012.
82 AAD, Séances de la Commission du musée (1889), C1/45, « Porte arabe ». Annie-Christine Daskalakis Mathews, « Porche d’une demeure mamelouke au Caire », in : Les Arts de l’Islam au musée du Louvre, éd. Sophie Makariou, Paris 2012, 261-264.
83 C’est vraisemblablement Charles Guimbard qui pousse Saint-Maurice à prendre une décision concernant le porche mamelouk.
84 AAD, Correspondance 1858-1980, Correspondance du 18 mai 1888 au 22 août 1889, B1/1, « Lettre du Secrétaire général de l’UCAD au comte de Saint-Maurice », feuillets 100-102.
85 AAD, Architecture, Aménagement des espaces d’exposition, B7/60, IV, pochette 6. Onze croquis tracés à main levée représentant un plan au sol, des relevés des parois, de la voûte, des écoinçons et de la voussure. Voir Daskalakis Mathews, Le porche mamlouk, 9. L’auteur attribue ces dessins à Saint-Maurice en se fondant sur une comparaison entre les indications manuscrites sur ces croquis et l’écriture du collectionneur visible sur deux lettres conservées dans les archives de la bibliothèque des Arts décoratifs. Nous doutons cependant d’une telle attribution dans la mesure où les lettres faisant référence aux croquis n’impliquent aucunement que ces derniers sont de la main de Saint-Maurice. La comparaison entre les annotations présentes sur les croquis du porche et la graphie de Charles Guimbard visible sur une lettre adressée au secrétaire général de l’UCAD nous autorise à penser que ces derniers sont de la main de l’architecte. AAD, Séances de la Commission du musée (1889), C1/45, « Porte arabe », lettre de Charles Guimbard, « Le Caire, le 8 mars 1889 ».
86 Daskalakis Mathews, « Un amateur d’architecture mamelouke au Caire », 105, et id., Le porche mamlouk, 5-6.
87 Daskalakis Mathews, Le porche mamlouk, 8-9. La lettre en question, adressée par le directeur général des Douanes au Secrétaire général de l’UCAD est relative à une demande d’exemption de droits de douane.
88 AAD, Commission du musée, C1/57, « Séance du 26 décembre 1900 ».
89 AAD, Séances de la Commission du musée, Acquisitions et propositions d’acquisitions : correspondance, photographies, 1898-1902, C1/53, Correspondance de 1899 à 1902, « Porte arabe. 20 décembre » : « Cher Monsieur, M. Maciet a examiné très sérieusement tous les éléments que vous nous proposez pour la reconstruction de la porte arabe. À son grand regret il ne croit pas pouvoir prendre [sans] un avis de ses collègues la responsabilité d’une restitution qui serait non seulement coûteuse mais qui contiendrait trop d’éléments modernes. Dans ces conditions il préfère vous rendre la liberté de traiter avec d’autres acheteurs. De notre côté nous considérons cette collection comme un ensemble de documents à prendre divisés. Le prix qui vous serait proposé serait nettement inférieur à celui que nous avons admis lorsque nous pensions à la reconstitution qu’il vaut mieux ne pas en parler pour l’instant espérant que vous trouverez un amateur qui s’offrira le luxe de restituer chez lui un admirable monument d’art arabe. » Louis Metman succède à Paul Gasnault ; il est conservateur de 1898 à 1941.
90 Gaston de Saint-Maurice décède le 5 juillet 1905 à Paris. Il est enterré à Compiègne dans l’actuel cimetière nord. Voir Archives de Paris, Archives des Pompes funèbres, 2484 W 27, « Convoi du 10 juillet 1905 ».
91 Archives de Paris, Enregistrement, Registre de l’année 1905, DQ 731693, « Déclaration de mutation par décès - Succession de Gaston de Saint-Maurice », Acte n° 117. Marie-Claire Esmangart de Bournonville de Saint-Maurice, veuve de Jean-François Maurice de Trémisot et Marie Berthe Esmangart de Bournonville de Saint-Maurice, veuve de Charles Marie Varin de la Brunelière, sont légataires universelles, conjointement pour le tout ou dépositaires dans la proportion de 2/3 pour Mme de Trémisot et d’1/3 pour Mme de la Brunelière. L’inventaire de la collection a été dressé par Me Delafon, notaire à Paris, le 28 juillet 1905.
92 Archives de Paris, Archives des Commissaires-priseurs, Étude de Paul Chevallier, D48E3 89, « Succession Saint-Maurice ». Les experts étaient Charles Mannheim pour les objets d’art, Jules Féral pour les tableaux et M. Durel pour les livres. Voir Catalogue des objets d’art, 1906. Le produit de la vente s’est élevé à 127780 francs.
93 Le contenu des différents lots n’est malheureusement détaillé ni dans le catalogue, ni dans le procès-verbal de la vente.
94 Kinney, Reuse Value, 1-11.
95 Cette pratique n’est pas exclusive à l’aristocratie. Elle se distingue néanmoins du phénomène de bibelotisation lié à la bourgeoisie.