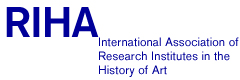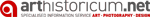RIHA Journal 0179 | 25 September 2017
L’architecture prospective en Tchécoslovaquie. Convergences et divergences entre l’approche du groupe slovaque VAL (1968-1994) et la théorie architecturale de Michel Ragon
Abstract
The article discusses the resonance of Michel Ragon’s concept of
prospective architecture in Czechoslovakia by taking the group VAL (Voies et
Aspects du Lendemain) as an example. The article focuses not only on the
similarities, but also on the divergences between the concept of prospective
architecture defined in France and VAL’s projects from the 1970s. The
article will try to reveal parallels between the VAL’s definition of
architecture as a result of a game and a way to anticipate the new society, and
the approach of architects and groups active in France as the Utopia, or the
Internationale Situationniste. In conclusion, the text will emphasize the
specificity of VAL’s projects, inseparably linked to the context of
Czechoslovakia during the period of Normalization, and stress its heterogeneous
characterlinking them more closely to the postmodern architecture.
Contents
Où vivrons-nous demain ?
Architecture prospective ou utopique ?
L’architecture comme jeu
L’architecture hétérogène
L’utopie est toujours la tentative d’un nouvel ordre social sur une petite échelle, par des minorités. L’utopie est une image contre-culturelle.
Michel Ragon, Où vivrons-nous demain ?, Paris 1963
[1] La notion d’architecture prospective apparait dans les écrits de Michel Ragon (né 1924), critique d’art et théoricien de l’architecture, dans les années soixante. Ayant « dénoncé le côté marchand, le côté spéculation qu’il y [avait] dans la peinture1 », Ragon, qui s’engageât initialement dans la promotion, à Paris, de la peinture abstraite, de l’art brut et de l’informel, développa par la suite une théorie de l’architecture. Dans son livre intitulé Où vivrons-nous demain ? publié en 19632 et dans le manifeste du GIAP (Groupe International d’Architecture Prospective) de mars 19653, Michel Ragon établit une distinction entre l’architecture prospective, dont les projets sont réalisables dans le futur (si l’échéance des constructions apparaît très lointaine, il préfère employer le terme de « futurologie »), et l’architecture utopique ou visionnaire dont les projets sont par nature impossibles à réaliser. Il reprit cette notion de « prospective » au philosophe français Gaston Berger (1896-1960) qui, en s’appuyant sur la théorie phénoménologique du temps de Henri Bergson (1859-1941), développa une philosophie d’anticipation du développement du monde moderne au cours des années cinquante. La prospective était une science de la prévision à long terme qui, selon Berger, supposait « de comprendre l’avenir et non pas de l’imaginer »4. Ragon utilisa ce terme pour designer les recherches d’une nouvelle génération d’architectes qui prôna à l’époque un renouveau dans le domaine de l’urbanisme et voulait se démarquer des principes de l’architecture standardisée et modulaire incarnée par Le Corbusier, ainsi que de la fadeur du Style International des premières décennies du xxe siècle. Cette architecture prospective se caractérisait par une grande pluralité formelle ; pour ses promoteurs, il s’agissait de dépasser les limitations du genre en rejetant des catégories habituellement associées au domaine de la construction, telles la stabilité, la pérennité, la rationalité et la pesanteur. A contrario, la nouvelle architecture apparaissait comme déplaçable, transformable, pneumatique ou légère et parfois éphémère. Les édifices décrits par Ragon correspondaient à des visions futurologiques souvent irréalisables, s’approchant considérablement des arts plastiques. Elles relevaient parfois du domaine de la sculpture ou prenaient la forme de dessins ou de photocollages.
[2] La théorie de l’architecture prospective élaborée par Michel Ragon eut un certain impact dans les pays d’Europe de l’Est, notamment en Tchécoslovaquie. L’intérêt pour ses écrits fut stimulé par la publication en 1967 de la traduction tchèque de son livre-manifeste Où vivrons-nous demain ?5, mais aussi par ses contacts directs avec le milieu artistique de Prague et de Bratislava6. Le travail architectural du collectif VAL (Voies et Aspects du Lendemain), formé à Žilina en 19727 par l’artiste Alex Mlynárčík (né 1934), relève par exemple d’une forme d’architecture visionnaire que Michel Ragon qualifia de « prospective ». Selon Mlynárčík, qui allait devenir un ami du critique français lors des années soixante8, ce sont les encouragements de Ragon qui l’incitèrent directement à élaborer et à développer ses idées dans le domaine de la création architecturale. C’est aussi à lui que Mlynárčík emprunte un vocabulaire théorique spécifique pour parler des réalisations de VAL. Ce sont enfin les concepts développés par Ragon qui suscitèrent l’intérêt des membres du groupe lors des phases d’élaboration de leurs projets. Cela dit, les artistes de VAL n’avaient pas pour objectif d’illustrer les théories esthétiques alors en vogue à Paris. Certes, dans ses projets, la formation s’en nourrit mais elle les utilisa selon ses propres besoins. La prise en compte du contexte est-européen local (slovaque), dans lequel VAL s’inscrit, est tout aussi fondamentale pour comprendre les intentions du groupe et la nature de ses réalisations. Pour finir, on observe sur certains aspects des divergences entre la formation slovaque et Ragon, notamment en ce qui concerne la question du potentiel contestateur de l’architecture prospective.
Où vivrons-nous demain ?
[3] Créé par un artiste (Alex Mlynárčík) et deux architectes (Viera Mecková et Ľudovít Kupkovič), le groupe VAL (Voies et Aspects du Lendemain) se singularisa sur la scène artistique est-européenne en raison de l’interdisciplinarité de ses pratiques. Avant de s’engager dans ce projet, Mlynárčík, un artiste diplômé9, acquit une renommée en composant des ‹ happenings ›. De grande ampleur, ses actions en plein air mettaient l’accent sur la participation active du spectateur10. Viera Mecková et Ľudovít Kupkovič, que Mlynárčík invita à participer au projet de VAL, étaient à l’époque des architectes exerçant activement leur profession à Žilina dans un bureau de l’entreprise nationale Stavoprojekt11. Entre 1968 et 1993, le groupe VAL a élaboré huit projets: trois villes-édifices, deux bâtiments-monuments, un hôtel, une salle de concert et un bâtiment destiné à l’Assemblée nationale. Tous ces projets se trouvent à mi-chemin entre l’art et l’architecture et pourraient être considérés comme des « villes-sculptures » ou « bâtiments-sculptures »12.
[4] Le premier projet collectif élaboré par le groupe VAL s’intitulait Héliopolis (figs. 1-2). Il s’agissait d’une ville-nid perchée au sommet des montagnes de Tatras, à la frontière polono-tchécoslovaque. Le groupe travailla sur ce projet entre 1968 et 1974. De 1974 à 1976, le groupe élabora son deuxième projet nommé Istroport (port sur le Danube), situé près de Bratislava (fig. 3-4). Enfin, VAL créa une troisième proposition de complexe urbain : la ville spatiale Scarabea (entre 1986 et 1989). Pour réaliser ces trois projets, le groupe s’appropria tout d’abord le concept de mégastructures. Caractéristiques de l’urbanisme moderne, les mégastructures supposaient la concentration de villes entières dans un cadre monumental préétabli. Elles furent imaginées comme des modèles architecturaux dynamiques techniquement avancés et auto-suffisants, engendrant toute l’activité de l’homme13.
1 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková, Ľudovít Kupkovič), Héliopolis, 1968-1974, photocollage, 90 x 90 cm, Collection d’Alex Mlynárčík, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
2 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková, Ľudovít Kupkovič), Héliopolis, 1968 -1974, encre sur papier, 90 x 90 cm, Collection de Viera Mecková, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
3 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková), Istroport, 1974-1976, encre sur papier, 90 x 90 cm, Collection de Viera Mecková, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
4 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková), Istroport, 1974-1976, photocollage, 90 x 90 cm, Collection d’Alex Mlynárčík, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
[5] Les bâtiments-sculptures constituent la deuxième catégorie des propositions de VAL, dans le cadre de laquelle nous pouvons énumérer les projets suivants : Akusticon, qui était un projet de salle de concert cinétique en forme d’œuf (1969-1971; fig. 5) ; l’édifice de l’Assemblée nationale d’Argillia, considéré comme un royaume imaginaire (1980-1994) ; ou encore E-Temen-An-Ki, une proposition pour l’hôtel Sheraton-Babylon (1980-1994; fig. 6-7).
5 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková), Akusticon, 1969-1971, encre sur papier, 90 x 90 cm, Collection de Viera Mecková, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
6 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková), E-Temen-An-Ki – hôtel Sheraton-Babylon, 1980-1994, encre sur papier, 90 x 90 cm, Collection de Viera Mecková, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
7 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková), E-Temen-An-Ki – hôtel Sheraton-Babylon, 1980-1994, photocollage, 90 x 90 cm, Collection d’Alex Mlynárčík, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
[6] Les sculptures-édifices pour des monuments commémoratifs constituent la dernière catégorie des projets de VAL. On peut citer ici deux réalisations : le monument en Hommage à l’espoir et au courage dédié à Eugene A. Cernan, astronaute américain d’origine slovaque et capitaine de la mission lunaire Apollo de 1972 (fig. 8-9) ; et Antarctica, un monument consacré à tous ceux « qui ont le courage de chercher »14 et dédié à James Scott et Roald Amundsen, explorateurs de l’Antarctique au début du xxe siècle.
8 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková, Ľudovít Kupkovič), Hommage à l’espoir et au courage. Monument pour Eugene A. Cernan, 1974-1975, encre sur papier, 90 x 90 cm, Collection de Viera Mecková, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
9 VAL (Alex Mlynárčík, Viera Mecková, Ľudovít Kupkovič), Hommage à l’espoir et au courage. Monument pour Eugene A. Cernan, 1974-1975, photocollage, 90 x 90 cm, Collection d’Alex Mlynárčík, Žilina (photographie : Archive du groupe VAL, Žilina)
[7] Remarquons que les travaux de VAL pourraient illustrer le livre de Ragon Où vivrons-nous demain ?. Toutes les variantes de l’architecture prospective catégorisées par le critique français figurent en effet dans le répertoire de VAL : mégastructures, villes spatiales, bâtiments sous-marins, structures gonflables, architectures-sculptures, villes suspendues, villes maritimes, maisons mobiles, architecture flexible, etc. Ce que Ragon décrit comme de nouvelles formes architecturales, le groupe VAL les a développées dans ses projets. Il s’agit tout d’abord de figures géométriques simples puis ovoïdes (le projet de l’Akusticon), de spirales et de coquilles (la ville Scarabea), de dômes et de sphères (Monument pour Eugene A. Cernan, Ambassade d’Argillia à Bora Bora), ou encore de bâtiments ressemblant à des soucoupes volantes (Héliopolis). Décrivant les bâtiments ovoïdes de VAL, Ragon indique que la série de sculptures de Constantin Brâncuşi intitulée Mademoiselle Pogany constitue une source d’inspiration probable15. Il est en effet vraisemblable que le groupe s’en soit inspiré, notamment pour créer le projet d’Akusticon.
[8] Dans ses réalisations, VAL aborde toutes les problématiques mentionnées par le critique français : l’hypertrophie des villes, l’urbanisation progressive de la campagne, les problèmes de circulation, l’exploitation des nouvelles énergies, l’établissement d’un nouveau rapport à la nature, la climatisation, l’expansion spatiale de l’homme. Dans son livre Où vivrons-nous demain ?, Ragon parle des villes parallèles, de la tour de Babel – l’idée fut reprise par VAL dans le projet d’E-Temen-An-Ki (une proposition pour l’hôtel Sheraton-Babylon) –, de l’architecture aux effets sonores – qui constitue un des aspects d’Akusticon –, et enfin de la construction de lieux de vacances – Héliopolis correspond précisément à un tel projet. D’autres visions architecturales de VAL se caractérisent même par leur ressemblance directe avec les travaux d’architectes présentés par Ragon. Par exemple, Istroport, conçu comme une ville parallèle à Bratislava, rappelle les propositions de villes flottantes de l’architecte français Paul Maymont (1926-2007), soutenu par Michel Ragon. De la même manière, l’œuf-maison conçu par l’architecte suisse Pascal Häusermann (1936-2011)16 pourrait constituer le modèle de l’Akusticon. Mentionnons aussi la tour conique de verre, The Mile High Illinois de Frank Lloyd Wright, datant de 1956 dont le livre de Ragon contenait une reproduction17 et qui évoque le projet E-Temen-An-Ki de VAL.
[9] Néanmoins, cette source d’inspiration directe ne prive pas les projets du VAL de leur originalité. Au contraire, VAL fut l’une des rares formations d’Europe centrale qui développa des projets d’architecture expérimentale spécifiques en relation avec les tendances mondiales de l’époque – remarquons d’ailleurs que les écrits de Ragon synthétisent les tendances architecturales mondiales de son temps. Il faut souligner également que l’intérêt du groupe slovaque pour le travail de Ragon était réciproque. C’est en 1971, dans la revue Les Chroniques de l’Art vivant, que Michel Ragon écrit pour la première fois sur les travaux architecturaux d’Alex Mlynárčík18. Par la suite, il mentionne le travail de VAL dans le troisième tome de son Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes dans lequel il reproduit aussi un photocollage représentant son projet nommé Héliopolis (1968)19. Dans cette publication, le critique français accorde une place importante à l’architecture de VAL dans la mesure où il associe le groupe à des formations et courants parmi les plus influents de l’époque dans le domaine de l’architecture expérimentale, telles Archigram ou le Métabolisme japonais. De sorte que Ragon reconnaît non seulement le caractère novateur des projets du groupe slovaque mais situe aussi à un même niveau d’importance les propositions architecturales produites de l’autre côté du rideau de fer.
Architecture prospective ou utopique ?
[10] Dans le troisième tome de l’Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes, Michel Ragon sépare les recherches sur l’architecture prospective et futurologique des visions utopiques. Les premières – sur la prospective – regroupent les études sur les possibilités futures de l’architecture et de l’urbanisme et proposent un vaste ensemble de solutions quant à l’organisation de la vie des hommes (la prévision prospective ne dépasse pas, d’après Ragon, la durée d’une génération). Les secondes – sur la futurologie – visent à s’accomplir dans le futur. D’après Ragon, la prospective et la futurologie s’opposent aux conceptions utopiques de l’architecture, lesquelles consistent en des fantasmes poétiques et imprécis, sans base technique ou scientifique tangibles, et ne proposant qu’une vision unique d’un monde nouveau20. Pour cet ensemble de raisons, l’utopie constitue selon Ragon une modalité négative de l’architecture visionnaire.
[11] De fait, sa critique du caractère peu rigoureux des utopies architecturales fait penser à l’argumentation développée par Karl Marx et Friedrich Engels prônant un socialisme scientifique en opposition au socialisme utopique du philosophe français Charles Fourier21. En 1880, Engels se positionne contre la doctrine du socialisme utopique élaborée au début du xixe siècle. Il reproche aux partisans de cette doctrine de vouloir créer une société idéale en négligeant les réalités sociales existantes ainsi que leur absence de rigueur dans les processus d’analyse et de construction d’un modèle social alternatif22. Plus d’un demi-siècle plus tard, Michel Ragon, auteur de plusieurs livres sur le prolétariat et d’une biographie révisée de Karl Marx23, développe un raisonnement similaire : selon lui, l’utopie ne doit pas constituer un modèle architectural alternatif, ni même social. Les aspects de sa critique sont les mêmes que ceux de Engels fustigeant le socialisme utopique ; il lui reproche son côté peu rigoureux, peu scientifique et trop détaché de la réalité socio-historique24.
[12] L’opinion de Ragon sur le concept d’utopie fut partagée par les membres de VAL. La distinction qu’il opère entre l’architecture utopique et prospective, dont les variantes constituent des projets futurologiques, est reprise de façon informelle par le groupe. En effet, les artistes essaient de donner à leurs propositions architecturales les caractéristiques d’un projet prospectif. Ils proposent une vision architecturale élaborée à partir d’un mode de production réel, donc possible à réaliser. Un plan de construction détaillé documente par exemple chaque proposition. De nombreux dessins préparatoires et des descriptions précises de l’objet à construire figurent également dans chaque projet. Enfin, les trois membres de VAL font état de nombreuses consultations qu’ils ont menées avec des urbanistes, écologistes, astrophysiciens, spécialistes du transport et de l’ingénierie lors de la préparation de leurs projets25. Dans la plupart de ses propositions, VAL donnait également des précisions en ce qui concerne les matériaux à partir desquels leurs immeubles devaient être bâtis. Enfin, les artistes inscrivirent chaque projet dans un contexte réel. Ainsi, la ville olympique Héliopolis se trouvait dans les hautes montagnes des Tatras, entre les stations de ski Zakopane du côté polonais et Poprad du côté slovaque ; l’Istroport côtoyait la ville de Bratislava.
[13] Tandis que, comme le remarque Laurent Baridon, « la prospective était une sorte d’utopie inverse, sans système et sans dogme, qui posait des questions inspirées par le travail des architectes »26, on perçoit dans la pratique du groupe VAL un certain intérêt pour la dimension politique et sociale habituellement associée au concept d’utopie que le critique français rejetait. Ragon, pour qui l’utopie architecturale est « une image contre-culturelle »27 mue par l’ambition de changer un ordre social établi, ne souscrit pas à l’orientation politique des formations d’architecture expérimentale comme Utopie en France ou Zünd-up en Autriche qui se sont développées dans la deuxième moitié des années soixante et des années soixante-dix28. Il dénonce même la nouvelle génération d’architectes en tant qu’ennemis de la prospective architecturale qui, selon, lui « se réclame[nt] à la fois de Marx, Engels et Fourier [et] reproche[nt] à la prospective de détourner l’attention des problèmes politiques immédiats »29. Le critique français les accuse de « ne concevoir que des mondes immuables dans une perfection mécaniste »30.
[14] Il semble que Ragon vise ici spécialement Utopie, une formation française regroupant des sociologues, des philosophes et des architectes désireux de créer un nouvel urbanisme et inspirée par l’œuvre du philosophe et sociologue Henri Lefebvre (1901-1991)31. Cette formation prônait le mariage entre l’architecture, ou plutôt l’urbanisme, et les sciences sociales. En s’appuyant sur la pensée de Lefebvre, et par son intermédiaire sur une vision marxiste de la société, ses membres considéraient l’urbanisme comme une production sociale, mais aussi comme le moyen d’établir une critique sociale radicale32. Mise en pratique dans le cadre de projets d’architecture pneumatique le plus souvent éphémères, la théorie de l’urbanisme visionnaire constitua l’un des positionnements de la gauche de l’époque33.
[15] Sachant que le premier projet architectural d’Alex Mlynárčík – Les Mégalithes du XXIe siècle – fut directement inspiré par une exposition organisée par Utopie, on pourra se demander quelles étaient les affinités entre cette formation et VAL, et par extension les autres groupes engagés dans la projection architecturale. Les Mégalithes du XXIe siècle consistait en un projet de monument pneumatique préparé au début de mai 1968 pour le festival d’art contemporain de "Châtillon des arts" qui devait être installée dans le parc municipal de Châtillon-sous-Bagneux, une petite ville de la banlieue sud de Paris (fig. 10). La structure pneumatique était constituée de sept longs tuyaux gonflés d’air, dressés verticalement et formant un cercle34. Pour la réaliser, Mlynárčík s’inspira de l’exposition intitulée Structures gonflables, organisée par Utopie en mars 1968, au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris35. La manifestation avait pour ambition de rapprocher l’art et l’architecture, mais aussi la technique et l’industrie de l’institution muséale, ceci afin d’établir un nouveau rapport entre l’architecture, la technique et la société. Les organisateurs de cette exposition entendirent promouvoir le gonflable afin de relever la fécondité et en quelque sorte l’omniprésence de l’imaginaire pneumatique symbolisant, selon eux, le futur de l’humanité36. Réalisé deux mois après cette exposition, le projet des Mégalithes s’inscrivait parfaitement dans le contexte de l’architecture expérimentale de l’époque en France37.
10 Alex Mlynárčík, Les Mégalithes du XXIe siècle, 1968, sept tubes de caoutchouc, 2.200 x 130 cm (photographie : Collection d’Alex Mlynárčík, Žilina)
[16] Afin de réaliser Les Mégalithes, une entreprise française intitulée S.A.T.U.J.O. et spécialisée dans la production de systèmes de tuyaux gonflables souples à usage technique, a procuré à Alex Mlynárčík sept tubes gonflables de caoutchouc, chacun de vingt-deux mètres de long et d’un mètre trente de diamètre. Malgré les efforts de l’artiste soutenu par une équipe de pompiers locaux, il s’est avéré impossible de soulever les tuyaux après qu’ils ont été remplis d’air. Les Mégalithes gonflés sont restés à l’abandon dans le parc municipal de Châtillon, en position horizontale, comme « une démonstration de l’échec de l’homme face aux lois de la physique »38. Le fait que ce projet ne fut jamais complètement abouti fut interprété par le critique d’art français Pierre Restany comme une prémonition de la crise de Mai. En comparant Les Mégalithes avec les deux projets de Cubic Packages (Empaquetages cubiques) de Christo, réalisé en 1966 puis en 1968 pour la quatrième édition de la Documenta de Kassel (au cours de laquelle il avait éprouvé les mêmes difficultés à ériger les structures pneumatiques)39, Restany constata que c’est l'échec de la réalisation du projet de Mlynárčík, donc la chute des mégalithes, qui avait généré la signification de l’œuvre de l’artiste. Il affirma que: « cette ‹ chute des mégalithes › va prendre tout son sens dans l’immédiat, avec les événements de mai ».40
[17] Pour Alex Mlynárčík, Les Mégalithes s’inscrivent dans le cadre du débat alors mené en France par le groupe Utopie sur la place de l’architecture et de l’urbanisme dans la vie actuelle. Par l’intermédiaire de ses propositions, Mlynárčík jette les bases d’une réflexion sur le nouveau rôle de l’artiste ou de l’architecte dans la société41. Néanmoins, les projets du Slovaque émergent d’un contexte sociopolitique distinct, ce qui amène à interpréter différemment ces travaux, qu’il s’agisse des Mégalithes ou d’autres projets architecturaux.
[18] Historien de l’architecture américaine, Marc Dessauce émit l’idée selon laquelle, dans le contexte du mouvement de mai 68, l’architecture gonflable développée par Utopie constituait une incarnation grotesque de la modernité :
The work of the architects of the Utopie group may serve to evoke that moment of agreement in excess: the rise of symbolic, inflatable fraternity between disciplines, across political and social boundaries, and the role of the pneumatics in the register of student protests, as a grotesque incarnation of modernity. (…) Inflatable domes, furniture and décor, proposals for pneumatic dwellings, events and happenings; the pneumatic imagination that began to flow out of the military and recreational realms in the late fifties would form a reverse image of such disenchantment, momentarily reanimating the spectacle of avant-gardism and technocracy.42
[19] D’après Dessauce, l’orientation idéologique d’Utopie et d’autres formations de l’époque développant l’architecture pneumatique marque une rupture avec la période de l’immédiat après-guerre, où la désillusion était très forte envers les chantres des utopies artistiques et sociales des années vingt et trente dont ni le discours ni les œuvres n’avaient empêché l’avènement des totalitarismes et la tragédie de la Seconde Guerre Mondiale. En outre, comme l’a signalé Jean Clair, la fascination des avant-gardes pour l’industrie revêtit rétrospectivement, dans l’immédiat après-guerre, une signification effrayante dans la mesure où la production industrielle était identifiée à la tragédie de l’Holocauste et à « l’industrialisation de la mort »43.
[20] A l’inverse, Dessauce constate que les promoteurs de l’architecture pneumatique de la fin des années soixante renouent avec les avant-gardes de l’entre-deux-guerres en reprenant notamment leur stratégie et en partageant leurs aspirations politiques. Cependant, pour le critique américain, cette reprise des principes avant-gardistes tels que l’universalisme, le progrès technique ou l’engagement possède une évidente dimension grotesque dans le cas de l’architecture pneumatique.
[21] Sur ce point, le travail d’Alex Mlynárčík diffère considérablement de celui des architectes français qui, comme le remarque Dessauce, ne semblent pas entretenir de doutes ni émettre de réserves quant au thème du progrès technique. Venant d’un pays du bloc de l’Est, Mlynárčík fut saturé de propagande socialiste, focalisée notamment sur les thèmes de l’accroissement économique et du développement technique et industriel44. Or, son travail sous-entend une certaine distance critique vis-à-vis des avant-gardes de l’époque moderne dont le discours trouvait, selon Boris Groys, non la rupture mais sa continuation dans la propagande stalinienne45. Pour cette raison, Les Mégalithes du XXIe siècle, dans sa forme inachevée, ne dénote pas seulement l’impuissance ponctuelle de l’artiste et de ses collaborateurs locaux ; comme le fit Pierre Restany en l’associant aux événements de Mai 68, on peut y voir une contestation du pouvoir technocratique ou administratif gouvernant la société, ainsi que l’échec symbolique de l’association entre l’art et l’industrie. C’est à propos des usages du langage architectural que Mlynárčík et le groupe VAL apparaissent distant vis-à-vis de la théorie de la prospective élaborée par Ragon et se rapprochent de l’architecture radicale française pour laquelle des changements formels de l’architecture et des nouvelles conceptions de l’urbanisme doivent accompagner les transformations sociales et politiques46. Cependant, dans le même temps, Mlynárčík et le groupe VAL semblent rejeter le discours propagandiste du pouvoir tchécoslovaque prônant l’amalgame de l’art (de l’architecture) et de l’industrie au nom de la construction d’un pays socialiste.
[22] Pour comprendre Les Mégalithes aussi bien que les projets de VAL, il paraît utile de se référer à la définition du concept d’utopie selon Paul Ricœur (1913-2005). Celui-ci définissait l’utopie en opposition à l’idéologie ; l’utopie permet selon lui d’instaurer une distance avec la réalité et de percevoir l’idéologie comme un processus47. Dans leurs projets, Mlynárčík et les architectes de VAL développent une critique sous-jacente des villes socialistes, aussi bien celles qui sont à l’état de projet que celles, bien réelles, que le pouvoir fit construire, telles Nowa Huta (« Nouvelle Ferronnière ») en Pologne ou Sztálinváros (« Stalineville », aujourd’hui Dunaújváros) en Hongrie – ces nouvelles villes industrielles construites dans les années cinquante devaient incarner l’idée de la ville idéale et comprenaient des cités-jardins48. En effet, il est loisible de considérer les projets Héliopolis ou Istroport comme des alternatives aux projets urbains alors développés dans les pays du bloc de l’Est. Rétrospectivement, Ľudovít Kupkovič a souligné que l’activité dans le cadre de VAL représentait pour lui une rupture avec le type d’activité professionnelle qu’il avait mené jusqu’alors :
Quand Viera Mecková et Alex Mlynárčík m’ont invité pour joindre VAL, je n’ai pas hésité. VAL représentait un nouveau défi : la création libre dans l’architecture, les rêves architecturaux, la poésie.49
[23] Ainsi, les travaux architecturaux de VAL et Les Mégalithes de Mlynárčík peuvent être considérés en première analyse comme un ensemble de propositions critiques vis-à-vis des conceptions de l’architecture et de l’urbanisme qui prédominaient dans les pays du bloc de l’Est alors sous le coup d’une forte propagande socialiste d’État. De sorte que si nous reprenons la thèse de Restany susnommée, l’échec du dressage de la structure des Mégalithes ne renverrait pas métaphoriquement à la crise sociale que fut le Mai 68 français, mais, comme nous allons le postuler, au déclin du Printemps de Prague.
L’architecture comme jeu
[24] Les projets de VAL s’inscrivaient souvent dans une perspective universelle : ils devaient tout d’abord être disséminés dans le monde entier – ou éventuellement dans le cosmos incommensurable ; de la même manière, ils sont dédiés à d’éminentes personnalités de l’histoire de l’humanité qui contribuèrent à l’élargissement de la perception du monde ; enfin, certains de ses projets réactualisent le concept d’État global – c’est le cas de l’Assemblée Nationale d’Argillia, mais également de E-Temen-An-Ki qui fait référence à l’histoire biblique de la tour de Babel. Pourtant, c’est le contexte local dans lequel ces travaux furent conçus qui détermine en premier lieu leur signification. N’oublions pas que VAL fut fondé au moment où la Tchécoslovaquie évoluait du stade des mutations issues du dégel poststalinien à une période de Normalisation50. La politique oppressive de l’État appliquant « un retour à l’ordre » eut pour conséquence de favoriser l’émergence de pratiques culturelles dissidentes, contrevenant aux règles établies du monde de l’art et aux conventions sociales imposées par ce même État. Ce fut particulièrement le cas dans la partie slovaque du pays, très touchée par la dévastatrice politique culturelle du gouvernement de Gustáv Husák51.
[25] Certes, Alex Mlynárčík lui-même déclara dernièrement que ses actions n’ont jamais eu le caractère d’une contestation directe du pouvoir52, mais cela n’interdit pas de voir dans les travaux architecturaux de VAL une critique en négatif de la vie sociale et politique de l’époque53. En raison de certaines de leurs caractéristiques, les propositions de VAL sont d’ailleurs considérées par des historiens d’art slovaques telle Jana Geržová comme relevant du domaine de l’art conceptuel54, lequel se singularisait précisément dans les pays du bloc de l’Est par son caractère contestataire55. Premièrement, elles constituaient des exemples de Project Art au sens classique du terme, dans la mesure où aucune réalisation tangible ne découlait de ses propositions. Ainsi, semblablement aux projets artistiques considérés comme conceptuels, le processus de création des travaux architecturaux prévalait sur le résultat final. Ainsi, les artistes de VAL soulignèrent à plusieurs reprises qu’ils n’avaient ni l’espoir ni l’ambition de passer au stade de la construction de ces bâtiments56. Alex Mlynárčík lui-même, en parlant de la finalité de leurs travaux, expliqua la chose suivante : « Pour nous, travailler sur un projet c’était un jeu. C’était gai. Nous n’avions jamais l’idée de le réaliser, mais on devait dire que c’était réalisable »57. Deuxièmement, l’optimisme qui se dégage de ces projets relativement aux thèmes du développement humain et social parait trop contrastée au regard de la réalité de la Tchécoslovaquie de l’époque pour pouvoir être appréhendé littéralement58.
[26] La dimension futurologique des projets de VAL n’a pas pour seul fondement la création de bâtiments et monuments aux formes novatrices ; les artistes prévoyaient également l’émergence de nouveaux rapports sociaux. Alex Mlynárčík confirma cette ambition du groupe en affirmant :
Nous avons réfléchi non seulement au bâtiment, mais également aux gens qui auraient pu vivre là-bas. Nous avons pensé à la communication, à la circulation des voitures, à tous les aspects techniques. Nos projets n’étaient pas seulement des images. Dans nos projets, il y avait également une réflexion sur la vie sociale et une pensée écologiste.59
[27] Les propositions de VAL incarnent donc le rêve d’une société meilleure, reposant sur des relations entre les hommes qui soient différentes de celles proposées par le pouvoir tchécoslovaque de l’époque. Contrairement à ce que l’on observe dans les villes du bloc de l’Est, VAL « réintroduit » l’espace public. Dans des régimes autoritaires comme celui de la Tchécoslovaquie à l’époque de la Normalisation, la distinction entre l’espace public et l’espace privé fut déclaré caduque. Comme l’affirma le philosophe français Claude Lefort (1924-2010) dans son analyse du système totalitaire, l’espace public, entendu comme un lieu d’expression et de production de liens sociaux, fut détruit faute d’extériorité dans les rapports entre le pouvoir et la société. En d’autres termes, le pouvoir s’identifia avec cette-dernière, ce qui eut comme conséquence l'absence d’espace public60.
[28] Dans l’un des chapitres intitulé Perspective du manifeste écrit à l’occasion de la fermeture par Pierre Restany du Musée national d’Art moderne suite aux évènements de Mai 196861, Mlynárčík livre sa conception encore très abstraite de l’architecture qui trouvera sa concrétisation dans ses projets et ceux du collectif VAL durant les années soixante-dix. Considéré par Tomáš Štrauss, critique d’art slovaque et ami de l’artiste comme l’unique travail de Mlynárčík à signification explicitement politique62, ce manifeste constitue avant tout son premier pas vers l’architecture prospective. Mlynárčík écrivit :
Considérons la société et le phénomène de l’explosion démographique. Un nouveau style de vie se forme rapidement, dans lequel se mêlent complémentairement découvertes techniques et progrès moraux. Nous organisons de vastes ensembles urbanistiques (sous la terre, sur l’eau et même dans les airs). Les milieux de vie se métamorphosent en gigantesques statues polychromes, faites de verre ou même de matières gonflables,pleines de soleil et de couleurs rayonnantes. Dans ces espaces, l’art change de forme. On crée des environnements dans les magasins. Les rues sont comme des Luna-Parks de lumière et de mouvement, et de petits fétiches hippies nous attendent probablement dans nos appartements. C’est toute la vie qui devient un immense jeu artistique ! Un jeu dont les règles rigoureuses sont définies par rapport à la Société. Un jeu optimiste et constructif, auquel les exclus d’autrefois participent, alors que les snobs et l’art pour l’art sont refoulés par l’ampleur de la demande.63
[29] La même année, peu après son retour en Tchécoslovaquie, Mlynárčík commença déjà à introduire ces postulats dans des projets architecturaux. Les édifices-agglomérations futuristes proposés par VAL sont plutôt d’immenses villages de vacances (Héliopolis en est littéralement un). Outre des zones résidentielles (les unités d’habitations et les garages), des infrastructures et des lieux de travail, le groupe définit des zones de commerce et de loisir, conçoit des espaces de détente, des terrasses et des espaces verts, des zones consacrés à l’activité sportive et aux promenades, et même des centres culturels. A l’intérieur de ses mégastructures, VAL semble vouloir créer des espaces égalitaires, renonçant à la hiérarchie au nom d’un nouveau collectivisme plus ludique que celui que les citoyens tchécoslovaques de l’époque vécurent au quotidien.
[30] L’aspect ludique des travaux de VAL les rapproche d’autres projets élaborés par des formations architecturales actives en Europe occidentale. Suivant les remarques de Michel Ragon, on observe des affinités entre la création de VAL et celle d’Archigram64. L’esthétique de ce groupe actif à Londres dans les années soixante, mettant en cause toutes divisions entre la culture high et low, découlait de sa fascination pour le consumérisme dans tous ses excès, notamment l’abondance des objets produits en série grâce aux progrès techniques, l’intrusion des images publicitaires et le développement effréné des mass médias65. Dans ce sens, on pourra dire qu’elle a constitué un équivalent du Pop Art dans le domaine de l’architecture66. Il s’agissait, selon le mot de Guy Debord, d’une architecture de la société moderne conditionnée par « une immense accumulation de spectacles »67, celles-ci étant un outil de propagande du pouvoir capitaliste et un « instrument d’unification »68 de cette société. Les espaces projetés matérialisent la joie perpétuelle des parcs d’attractions et la fascination pour l’esthétique de la marchandise.
[31] Les projets de VAL pourraient relever de cette architecture spectaculaire au sens où Guy Debord l’entendait. En effet, les formes des édifices qu’ils proposent sont futurologiques et esthétiquement séduisantes. Dans leurs projets, les membres du groupe mettent l’accent sur les espaces de détente et de commerce. En ce sens, ils proposent des édifices idéaux pour l’Homo ludens de Johan Huizinga, celui-ci considérant le jeu comme un élément de la vie sociale consubstantiel à la culture69. « L’effet de spectacle » est particulièrement perceptible dans trois des propositions du groupe slovaque. Village récréatif suspendu à la cime de montagnes, Héliopolis évoque des projets comme Instant City d’Archigram, conçu exactement à la même époque – Instant City date de 1968-1971 et Héliopolis fut imaginé entre 1968 et 1974. Akusticon, à l’intérieur duquel ce sont les visiteurs qui créent le concert par leurs mouvements dans l’espace du bâtiment, rappelle le fameux projet intitulé Fun Palace de l’architecte britannique Cedric Price, datant de 1961. Ce dernier projet correspondait à un centre culturel interdisciplinaire innovant, perpétuellement transformable selon les besoins de son public. Ensuite, E-Temen-An-Ki – hôtel Sheraton-Babylon fait penser au projet de ville situationniste New Babylon élaboré à partir de 1958 par Constant Nieuwenhuys (1920-2005), architecte néerlandais évoluant autour de Guy Debord (1931-1994) au sein de l’organisation Internationale Situationniste. Celui-ci élabora des maquettes de mégastructures translucides habillant une structure métallique en gravitation. Selon leur auteur, l’ensemble devait incarner un « rêve fantaisiste (…) réalisable du point de vue technique, (…) souhaitable du point de vue humain et (…) indispensable du point de vue social »70.
[32] Constant pense que l’architecture future résultera d’une révolution dans les mœurs et de l’abandon de la structure familiale bourgeoise. Incarnant la ville unitaire conceptualisée par Debord, New Babylon71 exprime un double refus : celui de la standardisation dans l’architecture et celui de la cité fonctionnelle où les habitants, profondément isolés « sont condamnées à s'ennuyer à mort »72. La société qui abrite l’agglomération de Constant relève d’un marxisme utopique. Cette agglomération était supposée résoudre le problème de l’aliénation par la collectivisation des moyens de production et l’automatisation du travail, pour vivre « une vie plus heureuse »73, sans propriété privée, sans aucune trace de hiérarchisation. La ville de Constant représente « une nouvelle conception de l’habitat collectif ayant le maximum d’espace social »74. Libérée de la nécessité du travail, la population new-babylonienne se préoccuperait notamment du développement de sa créativité à travers des jeux collectifs75.
[33] Tout comme New Babylon, les projets de VAL sont des villes couvertes, climatisées, incarnant l’idée d’un espace ouvert favorisant les actions communes. Ces projets prévoient la construction d’édifices et de monuments dont les formes seraient spectaculaires et techniquement novatrices. Les bâtiments ainsi conçus sont grands, translucides, suspendus aux sommets de montagnes, flottants dans l’eau, entièrement illuminés et couverts d’or. Qu’il s’agisse d’agglomérations, tant terrestres que situées dans le cosmos, d’hôtels ou encore de bâtiments publics, les membres de VAL mettent l’accent sur l’aspect ludique de la vie.
[34] Pourtant, toutes ces caractéristiques acquièrent une signification totalement distincte de celle des propositions de Constant eu égard au contexte dans lequel les travaux de VAL furent conçus. En effet, ceux-ci ne procèdent pas d’une fascination pour le consumérisme ; ils ne constituent pas non plus une critique du système capitaliste comme c’est le cas des propositions de villes situationnistes ou, plus tard, des projets d’architecture radicale autrichienne ou italienne76. En effet, ce n’est pas l’abondance matérielle qui constitue l’arrière-plan des projets de VAL, mais plutôt la dépression de la vie économique. Ainsi, les édifices que le groupe propose ne peuvent pas être interprétés comme une critique du système capitaliste ; ils répondent à la réalité de la Tchécoslovaquie normalisée. En outre, les thèmes du divertissement et du commerce, qui ont une importance considérable dans les projets de VAL, constituent deux aspects de la vie urbaine très négligés à une époque où l’espace public n’est qu’un espace dans lequel le pouvoir exerce son contrôle sur les citoyens77.
[35] Dans ce contexte, la pratique artistique de VAL reposant sur la création de mondes parallèles pourrait être décryptée comme une forme de résistance au pouvoir autoritaire, au sens où Michel Foucault la définit au cours des années soixante-dix. Plus précisément, le fort contraste entre l’optimisme qui émane de l’univers des projets de VAL et l’expérience de la réalité sociale tchécoslovaque de ce temps-là rend probable le postulat selon lequel VAL entendait faire acte de résistance. Cette pratique artistique pourrait servir de « catalyseur chimique qui permet[trait] de mettre en évidence les relations de pouvoir »78.
[36] L’un des objectifs des membres de VAL est de dénoncer une situation de crise sociale et de considérer, à tout le moins théoriquement, l’éventualité d’un changement politique, ce que semble confirmer Mlynárčík par son affirmation suivante :
Quand on regarde un État, son système d’organisation, on se rend compte que c’est un jeu. C’est l’assemblée des hommes qui joue. La politique c’est un jeu. Nous pourrons appliquer les règles de ce « jeu officiel » pour créer une nouvelle réalité sociale.79
[37] Les mégastructures de VAL constituent donc des villes idéales prospectives composées de bâtiments futurologiques. Elles devaient générer de meilleures relations sociales reflétant les principes d’égalité, de communication et de flexibilité, et auguraient donc de l’émergence d’une nouvelle collectivité. Si la dimension de la plupart des édifices est gigantesque, il s’agit néanmoins, d’une monumentalité apprivoisée. Ces propositions architecturales devaient anticiper de nouveaux rapports sociaux plus égalitaires, plus solidaires et plus en harmonie avec la nature.
[38] De la même manière, le processus de création devait avant tout relever du domaine du jeu pour les membres de VAL. En d’autres termes, c’était la perspective ludique qui devait primer. Projeter l’horizon d’une résistance possible ne semblait que secondaire dans les motivations du groupe. En effet, le divertissement semblait être aussi important pour le groupe slovaque que pour des penseurs comme Johan Huizinga qui exaltait le concept de jeu en en faisant un élément inséparable de la nature humaine. Celui-ci affirma que « sans un certain maintien de l’attitude ludique, aucune culture n’est possible »80. Guy Debord et le mouvement situationniste ayant repris la thèse de Huizinga, le positionnement de VAL semble s’inscrire dans cette mouvance informelle qui prend corps à l’époque et visait à critiquer la société capitaliste et fonctionnelle. Rappelons que l’Internationale Situationniste entendait dépasser l’antagonisme entre le divertissement et la vie réelle, « au profit d’une conception plus réellement collective du jeu »81.
[39] Lors de la période de la Normalisation, le simple fait de jouer acquerrait les caractéristiques d’une résistance. Néanmoins, cela constituait avant tout une sorte de remède à la réalité de la Tchécoslovaquie de l’époque qui « retourne à la normale » après la « dérive » du Printemps de Prague. Comme les trois membres de VAL l’ont souligné à plusieurs reprises, l’activité dans le cadre du groupe leur permettait de relativiser le choc de la Normalisation des années soixante-dix et quatre-vingts, y compris la régression dans le domaine de la politique culturelle du pays, sachant qu’au cours de ces années toute création artistique échappant au contrôle du pouvoir était considérée comme « une activité exclusiviste, antisociale » (« an exclusivistic, anti-social activity »)82. Dernièrement, Ľudovít Kupkovič affirma :
VAL constituait un hommage aux plus grandes personnalités de l’humanité. Le groupe rêvait de l’avenir de l’homme sur notre planète. VAL n’a pas réalisé de commandes d’investisseurs. Il s’agissait de s’évader hors de l’environnement limité par la censure d’État de l’époque. Cette formation est née d’un désir de créer de nouvelles visions pour l’avenir de l'homme libre, matérialisées en une nouvelle forme architecturale et artistique.83
[40] On peut déduire des paroles de Kupkovič que l’activité du groupe résultait avant tout d’un « besoin de s’évader » de la part de leurs trois membres fondateurs84. Ayant initialement un caractère strictement privé, cette activité a pris la dimension d’un projet libertaire, contrebalançant de la sorte le malaise des années Husák. Comme le souligne l’architecte, durant plus de vingt ans, ce sont les membres de VAL eux-mêmes qui fixèrent les règles de ce jeu qu’était la pratique de l’architecture expérimentale. Axé sur la recherche de la distraction, le processus de création s’apparentait à une sorte de thérapie contre le désespoir résultant de la clôture du cycle des avancées sociales initié dans les premiers mois de 1968. Il s’agissait ainsi de surmonter les frustrations professionnelles et les désillusions personnelles dans un pays subordonné à l’URSS. L’architecture de VAL devenait donc, en reprenant la formule situationniste, « une préparation de possibilités ludiques à venir »85. Elle servit à construire un discours optimiste, à développer un horizon meilleur. Et si dans le même temps, le processus de son invention relevait de la pratique du jeu, c’était pour mieux s’opposer à celui – absurde – pratiqué par le pouvoir alors en place.
L’architecture hétérogène
[41] Établir une généalogie des projets de VAL et mettre en lumière ses affinités conceptuelles et formelles avec d’autres théoriciens et plasticiens de l’époque, en France notamment, ne nous permettent pas seulement de multiplier les interprétations. Ce travail nous est également utile pour essayer de déterminer l’importance du groupe dans la création architecturale de son époque. Notons tout d’abord que le positionnement de VAL est difficile à appréhender. Certes, au premier abord, l’ensemble de leurs projets constitue une entité relativement homogène. Pourtant, l’étude plus approfondie de ceux-ci permet d’apercevoir des subtilités dont la prise en compte modifie considérablement la première interprétation faite de ces projets : les propositions de VAL n’apparaissent plus comme des vestiges datés de la prospective architecturale des années soixante86, mais comme des œuvres de transition entre le moderne et le postmoderne.
[42] Pour bien comprendre la complexité des projets de VAL, il est nécessaire de les replacer dans le contexte des débats de l’époque sur l’architecture et l’urbanisme. Il s’agit d’une tâche difficile dans la mesure où le groupe constitue un excellent exemple de formation artistique d’Europe centrale dont le travail est difficilement analysable selon les paradigmes développés par la critique artistique occidentale de l’autre côté du rideau de fer. Remarquons avant tout que la création de VAL recèle des parentés avec plusieurs tendances de l’architecture mondiale considérées comme antinomiques. Tout d’abord, elle relève du domaine de l’architecture prospective telle que Michel Ragon la théorisa ; ce type de création demeure attaché au concept de mégastructure et revendique l’aspect sculptural de l’architecture. Mais les propositions de VAL s’approchent également par certains aspects du travail d’autres groupes relevant de la mouvance dite de « l’architecture radicale », tel le groupe français Utopie. Les groupes relevant de cette mouvance avait pour ambition de dénoncer la condition sociale actuelle et de proposer une autre vision de la société en référence à la théorie marxiste renouvelée par Henri Lefebvre entre autres. Les écrits de Michel Ragon constituent indubitablement une importante référence pour VAL, non seulement en raison de l’accessibilité de son livre en Tchécoslovaquie, mais aussi de son rapport amical direct avec Alex Mlynárčík. Malgré tout, il est difficile de considérer que l’ensemble de l’œuvre de VAL, fruit de multiples recherches et d’un intense travail de collaboration ayant duré plus de vingt ans, relèverait d’une seule et même mouvance.
[43] Les analogies entre les travaux du groupe et la théorie de l’architecture développée en France dans les années soixante provoqua ultérieurement des critiques de la part de certains théoriciens d’architecture slovaques comme Matúš Dulla ou Henrieta Moravčíková. Ceux-ci ont jugé que l’ensemble de la création architecturale slovaque des années quatre-vingt, y compris l’œuvre de VAL, s’inscrivait dans le contexte d’une « modernité tardive », que les bâtiments étaient réalisés selon les conceptions modernistes des années soixante87. Cependant, ces chercheurs slovaques semblent négliger le fait que, dans quelques-uns des projets plus tardifs du groupe, on peut percevoir l’écho du courant postmoderne dans l’architecture. Ainsi, le dernier projet E-Temen-An-Ki ̶ hôtel Sheraton-Babylon, de 1980-1994, comporte deux aspects qui le rapprochent du mouvement de l’architecture postmoderne : son éclectisme stylistique et sa réinterprétation fantaisiste du passé. Autrement dit, la perspective de travail adoptée par VAL évoluait du local au global, tendait désormais à une dimension universelle et par la même au dépassement du contexte tchécoslovaque. Qu’il s’agisse de la Mésopotamie antique ou du voyage dans le cosmos, il est patent que les thèmes inspirant VAL sont très hétérogènes. L’éclectisme des références, dont font ainsi preuve les membres du groupe, est concomitant à la réintroduction de ce concept par l’architecte américain Charles Jencks (né 1939) dans son livre intitulé Le langage de l’architecture postmoderne88. Pour Jencks, il s’agit de promouvoir une architecture du paradoxe, de la métaphore et en quelque sorte de l’ironie. Dans la mesure où le projet nous décrit une ziggourat contemporaine ayant la fonction d’un hôtel de luxe, E-Temen-An-Ki ̶ hôtel Sheraton-Babylon illustre pleinement cette donne architecturale. Inspirée par la tour de Babel telle qu’elle fut représentée par le peintre flamand Pieter Brueghel l’ancien89, cette immense tour conique de 630 mètres ne relève plus du prospectif ragonien. L’idée audacieuse d’amalgamer la vision d’un immense hôtel de luxe avec une représentation picturale d’un motif de l’imaginaire biblique place ce projet du côté de la fiction. Dans le même temps, elle nous fait penser aux bâtiments des parcs d’attractions et expositions internationales ou même aux actuelles constructions fantasmagoriques réalisés à Dubaï.
[44] Si les membres du VAL s’engagent pour la création d’utopies réalisables, ils le font cependant dans des circonstances sociopolitiques qui ne permettent pas la concrétisation de ces visions technologiques. Les membres du VAL ne reprennent donc pas le concept de rupture avant-gardiste. En outre, le futur qu’ils projettent recèle nombre de citations du passé, de sorte que des temporalités distinctes coexistent et contribuent à multiplier les possibilités d’interprétations de ces travaux architecturaux. Sur ce point, E-Temen-An-Ki constitue de nouveau un bon exemple : le projet est en effet indissociable de la fascination qu’éprouvèrent les membres de VAL pour l’histoire biblique de la tour de Babel qui « a sans doute existé jadis »90. De sorte que l’on observe dans les projets de VAL une dynamique singulière : les artistes semblent évoluer entre utopie et nostalgie, entre la recherche de nouvelles formes architecturales – à une époque où les récits d’anticipation relevaient du possible – et le désir de réactiver un répertoire de formes universelles depuis l’aube de l’histoire.
[45] Pour finir, le positionnement du groupe VAL vis-à-vis de l’idéologie et de la théorie marxistes est très ambivalent. D’un côté, le thème de la société du jeu qui anima les projets de VAL contraste avec les thèmes prédominants de la société ouvrière et du culte du travail présents dans la propagande des pays socialistes. D’un autre côté, on dénombre un point commun entre l’approche globale du groupe et les positions de certains théoriciens de l’architecture et urbanistes soviétiques qui soulignèrent à l’époque que « pour résoudre scientifiquement le problème de la ville, nous devons commencer par étudier la vie dans la société »91. De plus, les postulats du marxisme renouvelés par des penseurs français tels qu’Henri Lefebvre qui, dans le domaine de l’urbanisme, prit position contre l’urbanisme partiel et l’habitat ségrégatif semblent trouver un écho dans des propositions du groupe. Celui-ci envisagea en effet la pratique d’un urbanisme projectif, dont la vision englobait à chaque fois une ville entière dans toute sa complexité – avec une attention particulière accordée aux aspects de la communication et de la détente. Ainsi, le recours au concept d’utopie effectué par le groupe rendait possible, à travers le langage architectural, le débat sur la situation sociale actuelle. Si, selon Louis Marin, « la pratique utopique dénonce indirectement une situation de crise historique »92, les membres de VAL s’en servirent également afin d’anticiper les orientations esthétiques d’un changement possible et de manifester leur désillusion vis-à-vis du présent.
Local Editor
Anne-Laure Brisac-Chraïbi, Institut national d'histoire de l'art, Paris
License
The text of this article is provided under the terms of the
Creative
Commons License CC-BY-NC-ND 4.0
1 Jean-Paul Ameline et Véronique Wiesinger, « Entretien avec Michel Ragon », in : Denise René l’intrépide. Une galerie dans l’aventure de l’art abstrait 1944-1978, cat. exp., Paris 2001, 68-74, ici 71.
2 Michel Ragon, Où vivrons-nous demain ?, Paris 1963.
3 Le manifeste du GIAP a été signé à Paris en mai 1965 par Michel Ragon, Yona Friedman, Walter Jonas, Paul Maymont, Georges Patrix, Ionel Schein et Nicolas Schöffer. Le groupe interdisciplinaire et international avait pour objectif de promouvoir des nouvelles recherches en architecture et urbanisme qui répondraient aux besoins de la société de l’avenir. Voir: Michel Ragon, éd., Les Visionnaires de l’architecture / Textes de Balladur, Friedman, Jonas, Maymont, Ragon, Schöffer, Paris 1965.
4 Gaston Berger, Jacques de Bourbon-Busset et Pierre Massé, De la prospective. Textes fondamentaux de la prospective française. 1955-1966, édité par Philippe Durance, Paris 2008.
5 Michel Ragon, Kde budeme žítzítra ?, Prague 1967. Sur ce sujet, voir : Ludmila Hájková et Rostislav Švácha, « Kde budeme žít zítra », in : Vít Havránek, éd., Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umení sedesátých let / Action, Word, Movement, Space: Experimental Art of the Sixties, cat. exp., Prague 1999, 114-159, 390-399. Dans les années soixante-dix, le livre de Ragon fut également traduit et édité en URSS, mais sans l’autorisation de l’auteur. D’après : Entretien de l’auteur avec Michel Ragon, Paris, le 4 février 2014.
6 Dans les années soixante, Ragon a effectué des voyages dans des pays d’Europe centrale et orientale, dans le cadre des congrès de l’AICA ̶ Association Internationale des Critiques d’Art, qui ont eu lieu en 1960 en Pologne (VIIe congrès à Varsovie) et en 1966 en Tchécoslovaquie (IXe congrès à Prague).
7 Si la collaboration entre les membres du groupe commence dès 1968, VAL fut fondé en 1972.
8 Alex Mlynárčík entra en contact avec Ragon par l’entremise d’un autre critique d’art français, Pierre Restany, devenu son ami lors de son voyage à Paris, en avril 1964. Voir: Pierre Restany, Ailleurs. Alex Mlynárčík, Paris 1994, 1-3. Également : Jindřich Chalupecký, Phíbeh Alexa Mlynárčíka. P.S. Zápisky z cesty A. M., Žilina 2011, 217-218.
9 Après avoir terminé ses études à l’École des Beaux-Arts (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava, Mlynárčík a été diplômé en 1965 de l’atelier de peinture monumentale de l‘Académie des Beaux-Arts (Akademie výtvarných umění) de Prague.
10 Sur ce sujet, consulter notamment: Restany, Ailleurs, 21-26 et 119-145 ; Jindřich Chalupecký, Na hranicích umění: několik příběhů, Prague 1990, 106-122 ; Radislav Matuštík, Predtým. Prekročenie hraníc: 1964-1971, [1983] réimpression inchangée Žilina 1994, 114-118 et 152-160 ; Radislav Matuštík, « Umenie akcie », in : Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. Storočie, éd. Zora Rusinová et al., Bratislava 2000, 163-169 ; Andrea Bátorová, Aktionskunst in der Slovakei in den 1960er Jahren. Aktionen von Alex Mlynárčík, Berlin 2009 ; Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Londres et New York 2012, 141-147.
11 Organisés en réseau sur tout le territoire du pays, les Stavoprojekt étaient des bureaux d’architecture et d’urbanisme fondés en 1948 et dont le but fut le renouvellement du design d’architecture et d’espaces publics, aussi bien que la construction de logements standardisés dans la Tchécoslovaquie socialiste. D’après: Pavol Mrázek et Jozef Skala, Stavoprojekt, Bratislava 1949-1989, Bratislava 1989.
12 Voir deux publications monographiques sur VAL: Voies et Aspects de Lendemain, VAL 1967-1976: Ľudovít Kupkovič, Viera Mecková, Alex Mlynárčík, cat. exp., Paris et Bratislava 1976 ; Ľudovít Kupkovič, Viera Mecková et Alex Mlynárčík, VAL. Cesty a aspekty zajtrajška / VAL. Voies et aspects du lendemain, Žilina 1995.
13 Sur ce sujet, consulter : Reyner Banham, Megastructure: Urban Futures of the Recent Past, Londres 1976 ; Michel Ragon, « Architecture et mégastructures », in : Communications 42 (1985), 69-77 ; Sarah Deyong, « Memories of the Urban Future: the Rise and Fall of the Megastructure », in : The Changing of the Avant-Garde: Visionary Architectural Drawings from the Howard Gilman Collection, cat. exp., éd. Howard Gilman et Terence Riley, New York 2002, 23-35.
14 Kupkovič, Mecková et Mlynárčík, VAL, 73. Voir également : Viera Mecková. Architektúra, knižná väzba, šperk, Žilina 2003, 35-46. Voir également des articles sur VAL parus dans la presse slovaque : Antonín Stuchl, « VAL 1967 až 1989. Slovo recenzenta », in : Projekt 1 (1992), 8-19 ; Vladimír Záborský, « Spomienky na minulosť, prítomnosť i budúcnosť » (Interview s členmi skupiny VAL), in : Projekt 4 (1995), 24-28 ; Ján Blahovec, « Seriál rozhovorov so Žilincami – Viera Mecková. Na projektoch prospektívnej architektúry sme pracovali takmer 30 rokov! », in : Žilinský včerník 44 (le 31 octobre 2006), 8 ; la deuxième partie : Žilinský včerník 45 (le 7 novembre 2006), 21, http://zilina-gallery.sk/wiki/Viera_Mecková; (consulté le 20 avril 2015); Helena Veličová, « Utópia v čase normalizácie », in : Vlna 51 (2012), 32-37. Les travaux de VAL sont également mentionnés dans des publications présentant un ensemble de la culture slovaque dans la deuxième moitié du XXe siècle, comme : Tomáš Štrauss, Slovenský variant moderny, Bratislava 1992, 73-78 ; Aurel Hrabušický, Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, cat. exp., Bratislava 2002, 154 ; Zuzana Bartošová, Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia, Bratislava 2011, 133-135. Voir égalment : Hájková et Švácha, "Kde budeme žít, 114-159, 390-399.
15 Ragon, Où vivrons-nous, 85.
16 Ragon, Où vivrons-nous, 113.
17 Ragon, Où vivrons-nous, 112.
18 Michel Ragon, « Alex Mlynarcik », in : Les Chroniques de l’Art vivant 26 (décembre 1971-janvier 1972), 20.
19 Michel Ragon, Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes, tome 3 : Prospective et futurologie, Paris 1978, 349-350. C’est à propos d’Héliopolis que Ragon a rédigé un texte accompagnant l’exposition du VAL à la galerie Lara Vincy, à Paris, en 1977. Michel Ragon, texte sans titre, in : VAL 1967-1976, s. n. ; texte publié également dans : Restany, Ailleurs, 247.
20 Ragon, Prospective et futurologie, 19-22 et 24-30.
21 Friedrich Engels, « Socialisme utopique et socialisme scientifique », in : La Revue socialiste 3 (1880) ; 4 (1880) ; 5 (1880), https://www.marxists.org/francais/marx/80-utopi/utopi-1.htm (consulté le 20 avril 2015).
22 Engels, « Socialisme utopique ».
23 Michel Ragon, Karl Marx, Paris 1959.
24 Le postulat de l’utopie réalisable fait penser aux propos des idéologues soviétiques tels qu’Andreï Jdanov (1896-1948) dont le livre sur l’art fut édité en Tchécoslovaquie dans des années cinquante. Celui-ci, en tant que théoricien du réalisme socialiste, posa les fondations de la politique culturelle stalinienne et développa la définition des artistes faite par Joseph Staline, selon lequel ils sont « les ingénieurs de l’âme ». Jdanov souligna que ces-derniers ne devaient surtout pas perdre le contact avec la vie réelle et non se réfugier dans « le monde irréel de l’utopie ». Andrej Ždanov, O umění, Prague 1950, 20, d’après : Veronika Halamová, Propaganda: the Instrument of the Communist Regime in Czechoslovakia 1948-1953, Lublin 2014, 28. De plus, on peut remarquer que le postulat de l’ancrage de architecture dans la réalité sociale fut soulevé par des visionnaires de l’architecture et urbanisme soviétiques. D’après : Jerome M. Gilison, The Soviet Image of Utopia, Baltimore et Londres 1975, 158-159 ; David Crowely et Susan E. Reid, « Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc », in : Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, éd. David Crowely et Susan E. Reid, Oxford et New York 2002, 10-12.
25 Lors de l’entretien à Žilina avec les membres du groupe VAL, le 21 mars 2013.
26 Laurent Baridon, « L’architecture, l’histoire et la fiction : le personnage de l’architecte dans les romans de Michel Ragon », in : Michel Ragon. Critique d’art et d’architecture, éd. Richard Leeman et Hélène Jannière, Rennes 2013, 77.
27 Une « image contre-culturelle » est le terme de Ragon employé dans son texte « Utopie et utopies » publié dans : Ragon, Prospective et futurologie, 24-30.
28 Sur ce sujet consulter notamment: Marc Dessauce, éd., The Inflatable Moment. Pneumatics and Protest in ’68, New York 1999.
29 Michel Ragon, Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes, tome 2 : Pratiques et méthodes, Paris 1972, 404.
30 Ragon, Histoire de l’architecture, tome 2, 403.
31 Fondée en 1966, Utopie regroupe trois sociologues : Jean Baudrillard, René Lourau et Catherine Cot, la paysagiste Isabelle Auricoste, trois jeunes architectes : Jean Aubert, Jean-Paul Jungmann et Antoine Stinco, et l’essayiste Hubert Tonka.
32 Henri Lefebvre, qui à cette époque était professeur à l’Institut de Sociologie Urbaine de l’Université Nanterre-Paris, s’intéressa au problème de l’organisation de la vie urbaine. Dans les publications suivantes : Le droit à la ville (de 1968), Du rural à l’urbain (1970), La pensée marxiste et la ville (1972) ou Espace et politique (1973), il écrivit sur les problèmes posés par le nouvel urbanisme et se focalisa sur le thème de l’espace considéré comme le produit de la société. Le point culminant de ses recherches fut marqué par son livre La production de l’espace, publié en 1974, présentant une réflexion sur la construction sociale de l’espace dans sa complexité et constituant une unité théorique abstraite entre l’espace physique, mental et social. Sur ce sujet, consulter: Łukasz Stanek, Henri Lefebvre on Space, Architecture, Urban Research, and the Production of Theory, Minneapolis 2011. En ce qui concerne les divergences d’analyses entre Lefebvre et des groupes français tels qu’Utopie ou l’Internationale Situationniste, consulter : Deborah Berke et Steven Harris, Architecture of the Everyday, New York 1997, 19-24.
33 Les objectifs théoriques du groupe ont été formulés dans sa propre revue intitulée Utopie, Revue de sociologie de l’urbain, dont le premier numéro a paru en mai 1967 et qui fut édité après la dissolution du groupe en 1971 jusqu’en 1978. Seuls les deux premiers cahiers de la revue (le premier, publié en mai 1967, et les numéros 2 et 3, jumelés dans un cahier édité en mai 1969), traitent de l’art et de l’architecture. Sur ce sujet consulter également : Craig Buckley et Jean-Louis Violeau, éd., Utopie. Texts and Projects, 1967-1978, Los Angeles 2007.
34 Sur ce sujet consulter : Restany, Ailleurs, 49-67 ; Matuštík, Predtým, 66, 203.
35 Structures gonflables. Mars 1968. Précédé d’un essai sur la technique et la société, de considérations inactuelles sur le gonflable et de particularité des structures gonflables, cat. exp., Paris 1968.
36 Mlynárčík, qui arrive en France en 1968 vers le mois de mai, n’a pas pu voir l’exposition, mais il a pu consulter le catalogue de cette manifestation édité sous forme d'un numéro spécial de la revue Utopie de laquelle aussi bien Michel Ragon que Pierre Restany étaient indubitablement familiers.
37 Les architectes d’Utopie eux-mêmes effectuèrent une tentative de construction de structures gonflables expérimentales similaire à celle de Mlynárčík. En juin 1967, ils tentèrent de réaliser une structure constituée de neuf tubes de nylon remplis d’air. Les reproductions de cet essai ont été publiées dans les numéros de décembre 1967 et janvier 1968 de la revue Architecture d’Aujourd’hui comme matériel illustratif de l’article présentant les principes du groupe intitulé « Voyage aux alentours d’utopie ». Voir: Raphaël Hythlodée, « Voyage aux alentours d’utopie », in: Architecture d’Aujourd’hui 135 (1967-1968), LXIII-LXVI, ici LXVI.
38 D’après l’entretien avec Alex Mlynárčík, à Žilina, le 21 mars 2013.
39 Il s’agit du 42,390 Cubic Feet Package, réalisé par Christo à Minneapolis en 1966 et 5,600 Cubicmeter Package, qui devait devenir le signal aérien de la Documenta IV de 1968. Ces deux structures gonflables verticales, de la même manière que Les Mégalithes de Mlynárčík, se sont dressées difficilement, ce qui eut pour effet de compromettre la réussite de l’événement. Sur ce sujet, consulter : Christo, Christo: 5600 Cubicmeter Package, 4. documenta Kassel 1968, Baierbrunn 1968 ; Alexander Tolnay, David Bourdon et Lawrence Alloway, éd., Christo and Jeanne-Claude: Early Works, 1958-1969, cat. exp., Cologne, Londres et Paris 2001.
40 Restany, Ailleurs, 51.
41 D’après l’entretien avec Alex Mlynárčík, à Žilina, le 21 mars 2013.
42 Dessauce, The Inflatable Moment, 13. « Le travail des architectes du groupe Utopie peut servir à évoquer le moment d’acmé suivant jusqu’à son paroxysme : la hausse du symbolique, de la fraternité pneumatique entre les disciplines à travers les frontières politiques et sociales, et le rôle des pneumatiques dans le registre des manifestations d’étudiants, comme une incarnation grotesque de la modernité. (...) Les dômes gonflables, le mobilier et la décoration, les propositions de logements pneumatiques, les événements et happenings; l'imagination pneumatique qui a commencé à s’écouler hors des domaines militaires et de loisirs à la fin des années cinquante formeraient l’image inversée d’un tel désenchantement, en ranimant momentanément le spectacle de l’avant-gardisme et de la technocratie » (ma traduction).
43 Jean Clair, « Dans la terreur de l'histoire », in : Giorgio de Chirico, cat. exp., éd. William Rubin, Wieland Schmied et Jean Clair, Munich et Paris 1983, 39-54.
44 Concernant la propagande en Tchécoslovaquie et dans les pays du bloc de l’Est, consulter: Harry Hodgkinson, Doubletalk: The Language of Communism , Londres 1955 ; Vladimir Reisky de Dubnic, Communist Propaganda Methods: A Case Study on Czechoslovakia, New York 1960 ; Halamová, Propaganda.
45 Selon la thèse principale de la publication: Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin, Munich et Vienne 1988.
46 Sur ce sujet, consulter: Hubert Tonka, « Le jeu de la technique », in: Utopie, Revue de la sociologie de l’urbain, 2 et 3 (1969), 120-147.
47 Paul Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia, New York 1986.
48 Voir: Anders Aman, Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era. An Aspect of Cold War History, Cambridge, Mass. 1994; Alexei Gutnov et al., The Ideal Communist City, New York 1978.
49 D’après l’entretien avec Ľudovít Kupkovič, à Žilina, le 10 avril 2014.
50 Voir: Bartošová, Napriek totalite, 57-108.
51 Sur ce sujet, consulter: Jozef Žatkuliak, « Slovakia in the Period of ‹ Normalization › and Expectation of Changes (1969-1989) », in: Sociológia / Slovak Sociological Review 3 (1998), 251-268.
52 D’après les propos d’Alex Mlynárčík, à Žilina, le 21 mars 2013. Contrairement aux interprétations de chercheurs tels que Piotr Piotrowski, l’historienne d’art slovaque Andrea Bátorová soutien l’idée du caractère non-politique des actions de Mlynárčík, en s’appuyant notamment sur son travail Happsoc I, effectué en collaboration avec un autre artiste, Stano Filko, et l’historienne d’art Zita Kostrová. Happsoc I prenait la forme d’un manifeste déclarant que la ville de Bratislava était « une œuvre d’art » pendant sept jours, du 2 au 8 mai 1965, c’est-à-dire dans une période comprise entre la Fête du Travail du 1er mai et la fête de l’Armée du 9 mai. D’après Piotrowski, en raison de la nature du territoire ainsi annexé, cette réalisation acquiert une dimension sociale mais devient également, par le choix de son contexte, une œuvre à caractère politique. Voir: Andrea Bátorová, « Alternative Trends in Slovakia during the 1960s and Parallels to Fluxus », in: Fluxus East, Fluxus East: Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa/ Fluxus Networks in Central Eastern Europe, cat. exp., Berlin 2007, 163-176, ici 172 ; Piotr Piotrowski, In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-Garde in Eastern Europe, 1945-1989, Londres 2009 ; d’après l’édition polonaise: Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005, 236.
53 Sur les travaux d’Alex Mlynárčík et du groupe VAL dans le contexte du régime communiste, voir notamment: Piotrowski, In the Shadow of Yalta, 228-229 ;David Crowley et Jane Pavitt, Cold War Modern: Design 1945-1970, cat. exp., Londres 2008, 21, 259-260 ; David Crowley, « The Art of Cybernetic Communism », in: Star City. The Future under Communism, cat. exp., éd. Łukasz Ronduda, Alex Farquharson et Barbara Piwowarska, Varsovie, Nottingham et Vienne 2011, 8-25, ici 22-23 ; Katarzyna Cytlak, « Idéologies des représentations architecturales. Les projets d’architecture des artistes d’Europe centrale des années 1970 comme critique sociale », in: Cahiers thématiques 12 (2013), 67-75. La lecture de l’œuvre de Mlynárčík à travers le prisme des relations entre le pouvoir et la scène artistique tchécoslovaque non-officielle n’est pas libre de controverses. Comme l’a remarqué Claire Bishop, Mlynárčík est l’un des artistes dont le positionnement pose des problèmes aux historiens d’art travaillant sur l’art est-européen de l’après-guerre. Bishop cite Mlynárčík, outre d’autres protagonistes de la scène culturelle slovaque, tels que Egon Bondy ou Ján Budaj, qui se trouvèrent sur la liste des collaborateurs avec le pouvoir communiste en place ; in: Claire Bishop, Artificial Hells, 141,147, 324. Mlynárčík, comme par exemple Tadeusz Kantor en Pologne, fut l’un des artistes qui sembla bénéficier d’une certaine tolérance du pouvoir lui permettant de mener à bien ses actions. Néanmoins, plusieurs travaux de l’artiste critiquent le fonctionnement tant du régime communiste que de la scène artistique officielle. Sur ce dernier point, son action Les Manifestations permanentes II, réalisée 1966 dans les toilettes publiques sur la place Hurban à Bratislava fut exemplaire. Initiée le 2 octobre de 1966, l’action constitua une alternative à l’ouverture du IXe congrès de l’Association Internationale des Critiques d’Art (AICA) organisé en Tchécoslovaquie. La participation, lors de l’inauguration de l’action, d’étrangers invités au congrès, tels Michel Ragon ou Pierre Restany qui s’absentèrent en conséquence des festivités officielles organisés à l’occasion du congrès causa, selon Restany, un « embarras dans les sphères politico-administratives [tchécoslovaques] ». Restany, Ailleurs, 25. Mlynárčík-même se rappelle de cette action dans: Chalupecký, Zápisky z cesty, 97-100.
54 Sur les projets de VAL dans le contexte de l’art conceptuel slovaque, consulter: Jana Geržová, « Konceptuálne umenie », in: Rusinová, Dejiny, 170-177, ici 175-176.
55 D’après: László Beke, « Conceptual Tendencies in Eastern European Art », in: Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s, cat. exp., éd. Jane Farver, New York 1999, 41-51; Éva Körner, « The Absurd as Concept: Phenomena of Hungarian Conceptualism », in: Joseph Kosuth. Zeno az ismert világ határán/ Zeno at the Edge of the Known World/ Zeno all'orlo del mondo conosciuto, cat. exp., éd. Katalin Keserü, Venise et Budapest 1993, 208-219.
56 Lors de l’entretien à Žilina avec les membres du groupe VAL, le 21 mars 2013.
57 D’après l’entretien avec Alex Mlynárčík, à Žilina, le 28 septembre 2007.
58 Les travaux de VAL relèvent de l’art néo-avant-gardiste slovaque, à l’instar des projets artistiques de Július Koller, Jozef Jankovič ou Stano Filko, produits en dehors du système officiel de commande artistique et acquérant souvent un caractère contestataire. Il faut remarquer que les propositions de VAL ne furent jamais exposées en Tchécoslovaquie. Ce n’est qu’après la dislocation du bloc de l’Est qu’eut lieu la première exposition slovaque du groupe, VAL – Cesty a aspekty zajtrajška (VAL – Voies et aspects du lendemain), organisée à Umelecká Beseda, à Bratislava, du 17 septembre au 13 octobre 1996. De plus, Ľudovít Kupkovič, entre 1971 et 1981, fut chassé de l’Union des Architectes Slovaques (Zväz slovenských architektov) en raison de ses « idées subversives » et de sa « liberté » dans le champ de la création architecturale. D’après: Kupkovič, Mecková, Mlynárčík, VAL. Cesty a aspekty, 136. En 1972 Mlynárčík fut également exclu de l’Union des artistes tchécoslovaques (Svaz československých výtvarných umělců). D’après: Ragon, Ailleurs, 25, et l’entretien mené avec Alex Mlynárčík, à Žilina, le 21 mars 2013.
59 L’information provient de l’entretien non-publié avec Alex Mlynárčík, à Žilina, le 28 septembre 2007.
60 Sur ce sujet consulter: Claude Lefort, L’invention démocratique: les limites de la domination totalitaire, Paris 1981, 127-128; également:Hugues Poltier, Passion du politique: la pensée de Claude Lefort, Lausanne 1998, 254-257.
61 Le 16 mai 1968Restany organisa la fermeture du Musée national d’Art moderne de Paris qui, après la Sorbonne, est considérée par lui comme « une autre Bastille bourgeoise à abattre ». D’après: Annabelle Ténèze, « Art et contestation: Pierre Restany et Mai 68 », in: Le demi-siècle de Pierre Restany, éd. Richard Leeman, Paris 2009, 141-156.
62 Tomáš Štrauss, « Three Model Situations of Contemporary Art Actions », in: Works and Words, cat. exp., éd. Josine van Droffelaar et Piotr Olszanski, Amsterdam 1979, 72, d’après: Bishop, Artificial Hells, 327.
63 Alex Mlynárčík, « Fermé pour cause d’inutilité, 18 mai 1968 ̶ Paris, Musée national d’Art moderne (Petites remarques à propos d’un grand événement) », in : Restany, Ailleurs, 59- 61, ici 61.
64 Ragon, texte sans titre, in: VAL 1967-1976, s. n.
65 D’après: Simon Sadler, Archigram: Architecture without Architecture, Cambridge, Mass. 2005, 5-7.
66 Sur ce sujet: Robert Venturi, « A Justification for a Pop Architecture », in: Arts and Architecture 4 (1965), 22; Chantal Béret, "Une architecture Pop ?," in: Les années Pop, 1956-1968, cat. exp., éd. Isabelle Merly, Paris 2001, s. n.
67 Guy-Ernest Debord, La Société du spectacle, Paris 1967, cité d’après: éd. Paris 1972, 15.
68 Debord, La Société du spectacle, 16.
69 Johan Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris 1988; première publication: Homo ludens, proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Haarlem, 1938.
70 Constant, « Une autre ville pour une autre vie », in: Internationale situationniste 3 (1959), 37-40, ici 40.
71 Notamment dans : Guy-Ernest Debord, « Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale », écrit à Paris, en juin 1957. Voir: Constant et Guy-Ernest Debord, « La déclaration d’Amsterdam », in: Internationale situationniste 2 (1958), 31-32 ; « L’Urbanisme unitaire à la fin des années 50 », in : Internationale situationniste 3 (1959), 11-16.
72 Constant, « Une autre ville pour une autre vie », 37.
73 Constant, « Une autre ville pour une autre vie », 37.
74 Constant, « Une autre ville pour une autre vie », 39.
75 Sur ce sujet, consulter: Libero Andreotti, Le grand jeu à venir. Textes situationnistes sur la ville, Paris 2007, 41, 223.
76 Utiliser l’architecture à des fins de contestation politique et sociale était une pratique par ailleurs très répandue parmi les adeptes de l’architecture radicale, tant italienne qu’autrichienne. Des formations comme Haus-Rucker-Co et Zünd-up de Vienne ou Superstudio de Florence développèrent une conception de l’architecture « dans un champ élargi » revendiquant par la même l’interdisciplinarité et l’utilisèrent comme une arme contre la société capitaliste. Sur ce sujet, consulter: Günther Feuerstein, « L’architecture visionnaire en Autriche pendant les années soixante et soixante-dix. Inspirations – influences – parallèles », in: Architecture radicale, cat. exp., éd. Frédéric Migayrou, Villeurbanne 2001, 86-101; Roberto, Gargiani, « Per una critica marxista della metropoli : la No-Stop City », in: La città nuova oltre Sant’ Elia. 1913-2013. Cento anni di visioni urbane, Milan 2013, 123-131.
77 Sur ce sujet, consulter: Crowely et Reid, Socialist Spaces.
78 Michel Foucault, « Le sujet et le pouvoir, 1982 », in: Michel Foucault. Dits et écrits, tome IV: 1980-1988, Paris 1994, 222-243.
79 Lors de l’entretien avec Alex Mlynárčík, à Žilina, le 10 juin 2012.
80 Huizinga, Homo ludens, 169.
81 « Contribution à une définition situationniste du jeu », in: Internationale situationniste 1 (1958), 9-10.
82 Reisky de Dubnic, Communist Propaganda, 181.
83 D’après l’entretien avec Ľudovít Kupkovič, à Žilina, le 10 avril 2014.
84 La « privatisation » de la création plastique résultant du besoin de fuir des artistes en réponse au contrôle exercé par l’État fut un phénomène particulièrement commun en Tchécoslovaquie à l’époque de la Normalisation. En Slovaquie, ce fut notamment l’environnement naturel ̶ la campagne ou les hautes montagnes ̶ qui est devenu un lieu privilégié de production artistique échappant à la censure. Sur ce sujet, consulter: František Šmejkal, « Z mesta von / Out of the City », in: Z mesta von. Umenie v prírode / Out of the City. Land Art, cat. exp., éd. Daniela Čarná, Bratislava 2007, 12-15; Paulina Bren, « Weekend Gateways: The Chata, the Tramp, and the Politics of Private Life in Post-1968 Czechoslovakia », in: Socialist Spaces, éd. Crowely et Reid, 123-140.
85 « Contribution à une définition situationniste du jeu », 10.
86 L’architecte slovaque Antonín Stuchl, dans le texte du catalogue de VAL de 1995, reconnaît l’effort du groupe pour solutionner des problèmes de la société actuelle tels que la hausse démographique et la dévastation de l’environnement naturel. Il est cependant plus critique sur le sujet des mégastructures développées par le groupe, qui, comme il le souligne, « ne sont pas à [s]on gout ». Antonín Stuchl, « Chaque exposition », in: Kupkovič, Mecková, Mlynárčík, VAL. Cesty a aspekty, 11.
87 Matúš Dulla et Henrieta Moravčíková, Architektúra slovenska v 20. Storočí, Bratislava 2002, notamment le chapitre: « Moderna značne neskorá » [La moderne beaucoup plus tard], 211-234, ici 233. Dans son texte « L’architecture du modernisme au réalisme socialiste et de retour », Dulla parle du travail de VAL en utilisant les termes de l’architecture moderne. Il affirme que les projets du groupe « ont incarné le grand esprit de la modernité avec son enthousiasme idéal et élan ». (« Stelesňovali skvelého ducha modernity s jeho ideálnym entuziazmom a rozmachom »). Matúš Dulla, « Architektúra od moderny k sorele a spät’ 1950-1970 », in: Rusinová, Dejiny, 223-228, ici 227. Sur la polémique avec Dulla et Moravčíková, consulter: Ján Bahna, « Osemdesiate roky v architektúre Slovenska: poznámky k výstave v SNG », in: Fórum architektúry, 7-8 (2009), 18, http://www.archinet.sk/magazine/Clanok.asp?ClanokID=9&VydanieKOD=99&Magazine=forum (consulté le 2 mai 2015).
88 Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture, Londres 1977.
89 Il s’agit du tableau à l’huile La Tour de Babel de 1563, appartenant à la collection du Kunsthistorisches Museum de Vienne.
90 Kupkovič,Mecková, Mlynárčík, VAL. Cesty a aspekty, 107.
91 « To resolve the problem of the city scientifically we must begin by studying life in the society, that is, the sum of relationships and wider associations shaping all social experience in time and space. » Gutnov, The Ideal Communist City, 11 (ma traduction).
92 Louis Marin, Utopiques : jeux d’espaces, Paris 1973 ; cité d’après l’édition de 2009, 207.